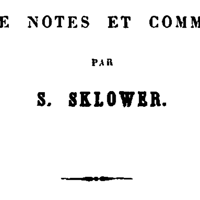Il s’agit de « La Tragédie de Didon » et autres œuvres de Jean-Jacques Le Franc, marquis de Pompignan, poète et magistrat français, traducteur de l’hébreu, du grec, du latin, de l’anglais et de l’italien, traîné dans la boue par Voltaire et par les philosophes (XVIIIe siècle). « Nous avons pris l’habitude de porter sur le XVIIIe siècle un jugement sommaire et sans appel », dit un historien 1. « Voltaire, Diderot, d’Alembert donnent à cette période intellectuelle sa signification dominante. L’effort de ces puissants écrivains fut si violent ; l’appui tacite… qu’ils rencontrèrent chez leurs contemporains fut si bien concerté ; la protection dont les couvrirent les potentats aida si bien leur propagande… qu’à eux seuls les Encyclopédistes paraissent exprimer les tendances morales de [tout] leur siècle ». Mais à côté de cette uniformité dans les tendances se distinguent des figures divergentes, comme celle de Pompignan : éclairées, mais farouchement chrétiennes ; protectrices des intérêts populaires, mais rigoureusement dévouées au Roi de France ; des figures moyennes qui, sans renier les nouveaux acquis de l’esprit humain, demeuraient respectueuses envers les vieux symboles, et qui refusaient de croire que, pour allumer le flambeau de la philosophie, on devait éteindre celui de la chrétienté. Ces figures moyennes, dit Pompignan, parlant donc de lui-même 2, « qui [ont peut-être réussi] médiocrement dans [leur] genre, n’ont pas du moins à se reprocher d’avoir insulté les mœurs, ni la religion. Quoi qu’en disent les plaisants du siècle, il vaut mieux encore ennuyer un peu son prochain, que de lui gâter le cœur ou l’esprit. » Telle était la position de Pompignan lorsqu’arriva le 10 mars 1760, le jour de sa réception à l’Académie française au fauteuil de Maupertuis. Porté à l’apogée de sa gloire, il crut un moment au bonheur et eut l’audace d’ouvrir son discours de réception par des attaques impersonnelles contre les livres des Lumières, qu’il accusa de porter l’empreinte « d’une littérature dépravée, d’une morale corrompue et d’une philosophie altière, qui sape également le trône et l’autel ». Attaquer ainsi en pleine séance les livres des gens de lettres dont il devenait le collègue, était une erreur ou à tout le moins une inconvenance, que Pompignan paya au centuple. Une pluie d’injures, de libelles, de quolibets, de facéties et, malheureusement, d’accusations mensongères s’abattit sur lui de la part des Encyclopédistes. « Il ne faut pas seulement le rendre ridicule », écrivait Voltaire à d’Alembert dans une lettre 3, « il faut qu’il soit odieux. Mettons-le hors d’état de nuire… » Le signal était donné. Voltaire, toujours adroit à manier l’arme de la malice, épuisa, en prose et en vers, tous les moyens de rire aux dépens de Pompignan et de ses « Poésies sacrées ». Pas un jour ne se passa sans qu’un trait acéré ne vînt s’ajouter à ceux de la veille
 tragédie française
tragédie française
sujet
Pompignan, « Œuvres. Tome II »
Il s’agit des « Odes » et autres œuvres de Jean-Jacques Le Franc, marquis de Pompignan, poète et magistrat français, traducteur de l’hébreu, du grec, du latin, de l’anglais et de l’italien, traîné dans la boue par Voltaire et par les philosophes (XVIIIe siècle). « Nous avons pris l’habitude de porter sur le XVIIIe siècle un jugement sommaire et sans appel », dit un historien 1. « Voltaire, Diderot, d’Alembert donnent à cette période intellectuelle sa signification dominante. L’effort de ces puissants écrivains fut si violent ; l’appui tacite… qu’ils rencontrèrent chez leurs contemporains fut si bien concerté ; la protection dont les couvrirent les potentats aida si bien leur propagande… qu’à eux seuls les Encyclopédistes paraissent exprimer les tendances morales de [tout] leur siècle ». Mais à côté de cette uniformité dans les tendances se distinguent des figures divergentes, comme celle de Pompignan : éclairées, mais farouchement chrétiennes ; protectrices des intérêts populaires, mais rigoureusement dévouées au Roi de France ; des figures moyennes qui, sans renier les nouveaux acquis de l’esprit humain, demeuraient respectueuses envers les vieux symboles, et qui refusaient de croire que, pour allumer le flambeau de la philosophie, on devait éteindre celui de la chrétienté. Ces figures moyennes, dit Pompignan, parlant donc de lui-même 2, « qui [ont peut-être réussi] médiocrement dans [leur] genre, n’ont pas du moins à se reprocher d’avoir insulté les mœurs, ni la religion. Quoi qu’en disent les plaisants du siècle, il vaut mieux encore ennuyer un peu son prochain, que de lui gâter le cœur ou l’esprit. » Telle était la position de Pompignan lorsqu’arriva le 10 mars 1760, le jour de sa réception à l’Académie française au fauteuil de Maupertuis. Porté à l’apogée de sa gloire, il crut un moment au bonheur et eut l’audace d’ouvrir son discours de réception par des attaques impersonnelles contre les livres des Lumières, qu’il accusa de porter l’empreinte « d’une littérature dépravée, d’une morale corrompue et d’une philosophie altière, qui sape également le trône et l’autel ». Attaquer ainsi en pleine séance les livres des gens de lettres dont il devenait le collègue, était une erreur ou à tout le moins une inconvenance, que Pompignan paya au centuple. Une pluie d’injures, de libelles, de quolibets, de facéties et, malheureusement, d’accusations mensongères s’abattit sur lui de la part des Encyclopédistes. « Il ne faut pas seulement le rendre ridicule », écrivait Voltaire à d’Alembert dans une lettre 3, « il faut qu’il soit odieux. Mettons-le hors d’état de nuire… » Le signal était donné. Voltaire, toujours adroit à manier l’arme de la malice, épuisa, en prose et en vers, tous les moyens de rire aux dépens de Pompignan et de ses « Poésies sacrées ». Pas un jour ne se passa sans qu’un trait acéré ne vînt s’ajouter à ceux de la veille
Pompignan, « Œuvres. Tome I »
Il s’agit des « Poésies sacrées » et autres œuvres de Jean-Jacques Le Franc, marquis de Pompignan, poète et magistrat français, traducteur de l’hébreu, du grec, du latin, de l’anglais et de l’italien, traîné dans la boue par Voltaire et par les philosophes (XVIIIe siècle). « Nous avons pris l’habitude de porter sur le XVIIIe siècle un jugement sommaire et sans appel », dit un historien 1. « Voltaire, Diderot, d’Alembert donnent à cette période intellectuelle sa signification dominante. L’effort de ces puissants écrivains fut si violent ; l’appui tacite… qu’ils rencontrèrent chez leurs contemporains fut si bien concerté ; la protection dont les couvrirent les potentats aida si bien leur propagande… qu’à eux seuls les Encyclopédistes paraissent exprimer les tendances morales de [tout] leur siècle ». Mais à côté de cette uniformité dans les tendances se distinguent des figures divergentes, comme celle de Pompignan : éclairées, mais farouchement chrétiennes ; protectrices des intérêts populaires, mais rigoureusement dévouées au Roi de France ; des figures moyennes qui, sans renier les nouveaux acquis de l’esprit humain, demeuraient respectueuses envers les vieux symboles, et qui refusaient de croire que, pour allumer le flambeau de la philosophie, on devait éteindre celui de la chrétienté. Ces figures moyennes, dit Pompignan, parlant donc de lui-même 2, « qui [ont peut-être réussi] médiocrement dans [leur] genre, n’ont pas du moins à se reprocher d’avoir insulté les mœurs, ni la religion. Quoi qu’en disent les plaisants du siècle, il vaut mieux encore ennuyer un peu son prochain, que de lui gâter le cœur ou l’esprit. » Telle était la position de Pompignan lorsqu’arriva le 10 mars 1760, le jour de sa réception à l’Académie française au fauteuil de Maupertuis. Porté à l’apogée de sa gloire, il crut un moment au bonheur et eut l’audace d’ouvrir son discours de réception par des attaques impersonnelles contre les livres des Lumières, qu’il accusa de porter l’empreinte « d’une littérature dépravée, d’une morale corrompue et d’une philosophie altière, qui sape également le trône et l’autel ». Attaquer ainsi en pleine séance les livres des gens de lettres dont il devenait le collègue, était une erreur ou à tout le moins une inconvenance, que Pompignan paya au centuple. Une pluie d’injures, de libelles, de quolibets, de facéties et, malheureusement, d’accusations mensongères s’abattit sur lui de la part des Encyclopédistes. « Il ne faut pas seulement le rendre ridicule », écrivait Voltaire à d’Alembert dans une lettre 3, « il faut qu’il soit odieux. Mettons-le hors d’état de nuire… » Le signal était donné. Voltaire, toujours adroit à manier l’arme de la malice, épuisa, en prose et en vers, tous les moyens de rire aux dépens de Pompignan et de ses « Poésies sacrées ». Pas un jour ne se passa sans qu’un trait acéré ne vînt s’ajouter à ceux de la veille
le père Porée, « Le Paresseux : comédie »
Il s’agit de la comédie « Le Paresseux » (« Otiosus ») du père Charles Porée, jésuite français d’expression latine, le professeur le plus admiré de son temps (XVIIIe siècle). Le professorat ne fut jamais pour le père Porée ce qu’il était pour la plupart de ses collègues — un passe-temps provisoire, destiné à occuper le religieux pendant ses premières années de sacerdoce. On trouve au contraire en sa personne un modèle de ces pédagogues perpétuels, ces « magistri perpetui », qui se vouent pour la vie à l’éducation de la jeunesse, sans chercher d’autre emploi pour les facultés de leur esprit. Sitôt sa formation religieuse terminée, le père Porée fut chargé d’une classe ; quarante-huit ans après, quand la mort vint le surprendre, elle le trouva encore à son poste au collège Louis-le-Grand. Durant toutes ces décennies, il ne sortit presque jamais du collège, tranchant ainsi avec les habitudes mondaines des Bouhours, des Rapin, des La Rue, dont il se montra pourtant le digne successeur. Non seulement il enseignait l’amour des belles-lettres à ses élèves, mais encore il vivait avec eux, il démêlait leurs dispositions, il parlait à leur cœur, il savait à l’avance leurs vertus, leurs vices, et quand enfin il les rendait à la société qui les lui avait confiés, il pouvait dire sur quels hommes elle pouvait compter. Ses élèves demeuraient ses amis, et tous se faisaient un devoir de le consulter dans les grandes occasions de la vie et de suivre son avis. Voltaire fut de leur nombre, et le père Porée, qui avait deviné et encouragé ses premiers succès, disait parfois, en entendant parler de son irréligion : « C’est ma gloire et ma honte ». Mais au fond de lui, il aimait trop les talents littéraires et il en était trop bon juge pour ne pas être flatté d’avoir contribué à ceux d’un tel élève. On cite souvent la lettre écrite par Voltaire après la mort du père Porée, et où le disciple fait de son maître cet éloge : « Rien n’effacera dans mon cœur la mémoire du père Porée, qui est également chère à tous ceux qui ont étudié sous lui. Jamais homme ne rendit l’étude et la vertu plus aimable. Les heures de ses leçons étaient pour nous des heures délicieuses, et j’aurais voulu qu’il eût été établi 1 dans Paris comme dans Athènes que l’on pût assister à tout âge à de telles leçons. Je serais revenu souvent les entendre… Enfin, pendant les sept années que j’ai vécu en [son collège], qu’ai-je vu chez [lui] ? La vie la plus laborieuse, la plus frugale, la plus réglée. Toutes ses heures partagées entre les soins qu’[il] nous donnait et les exercices de sa profession austère »
le père Porée, « Le Joueur : comédie »

dans « Théâtre européen, nouvelle collection. Théâtre latin moderne » (XIXe siècle), p. 43-76
Il s’agit de la comédie « Le Joueur » (« Aleator ») du père Charles Porée, jésuite français d’expression latine, le professeur le plus admiré de son temps (XVIIIe siècle). Le professorat ne fut jamais pour le père Porée ce qu’il était pour la plupart de ses collègues — un passe-temps provisoire, destiné à occuper le religieux pendant ses premières années de sacerdoce. On trouve au contraire en sa personne un modèle de ces pédagogues perpétuels, ces « magistri perpetui », qui se vouent pour la vie à l’éducation de la jeunesse, sans chercher d’autre emploi pour les facultés de leur esprit. Sitôt sa formation religieuse terminée, le père Porée fut chargé d’une classe ; quarante-huit ans après, quand la mort vint le surprendre, elle le trouva encore à son poste au collège Louis-le-Grand. Durant toutes ces décennies, il ne sortit presque jamais du collège, tranchant ainsi avec les habitudes mondaines des Bouhours, des Rapin, des La Rue, dont il se montra pourtant le digne successeur. Non seulement il enseignait l’amour des belles-lettres à ses élèves, mais encore il vivait avec eux, il démêlait leurs dispositions, il parlait à leur cœur, il savait à l’avance leurs vertus, leurs vices, et quand enfin il les rendait à la société qui les lui avait confiés, il pouvait dire sur quels hommes elle pouvait compter. Ses élèves demeuraient ses amis, et tous se faisaient un devoir de le consulter dans les grandes occasions de la vie et de suivre son avis. Voltaire fut de leur nombre, et le père Porée, qui avait deviné et encouragé ses premiers succès, disait parfois, en entendant parler de son irréligion : « C’est ma gloire et ma honte ». Mais au fond de lui, il aimait trop les talents littéraires et il en était trop bon juge pour ne pas être flatté d’avoir contribué à ceux d’un tel élève. On cite souvent la lettre écrite par Voltaire après la mort du père Porée, et où le disciple fait de son maître cet éloge : « Rien n’effacera dans mon cœur la mémoire du père Porée, qui est également chère à tous ceux qui ont étudié sous lui. Jamais homme ne rendit l’étude et la vertu plus aimable. Les heures de ses leçons étaient pour nous des heures délicieuses, et j’aurais voulu qu’il eût été établi 1 dans Paris comme dans Athènes que l’on pût assister à tout âge à de telles leçons. Je serais revenu souvent les entendre… Enfin, pendant les sept années que j’ai vécu en [son collège], qu’ai-je vu chez [lui] ? La vie la plus laborieuse, la plus frugale, la plus réglée. Toutes ses heures partagées entre les soins qu’[il] nous donnait et les exercices de sa profession austère »
« Théâtre jésuite néo-latin et Antiquité : sur le “Brutus” de Charles Porée (1708) »

éd. École française de Rome, coll. de l’École française de Rome, Rome
Il s’agit de la tragédie « Brutus » du père Charles Porée, jésuite français d’expression latine, le professeur le plus admiré de son temps (XVIIIe siècle). Le professorat ne fut jamais pour le père Porée ce qu’il était pour la plupart de ses collègues — un passe-temps provisoire, destiné à occuper le religieux pendant ses premières années de sacerdoce. On trouve au contraire en sa personne un modèle de ces pédagogues perpétuels, ces « magistri perpetui », qui se vouent pour la vie à l’éducation de la jeunesse, sans chercher d’autre emploi pour les facultés de leur esprit. Sitôt sa formation religieuse terminée, le père Porée fut chargé d’une classe ; quarante-huit ans après, quand la mort vint le surprendre, elle le trouva encore à son poste au collège Louis-le-Grand. Durant toutes ces décennies, il ne sortit presque jamais du collège, tranchant ainsi avec les habitudes mondaines des Bouhours, des Rapin, des La Rue, dont il se montra pourtant le digne successeur. Non seulement il enseignait l’amour des belles-lettres à ses élèves, mais encore il vivait avec eux, il démêlait leurs dispositions, il parlait à leur cœur, il savait à l’avance leurs vertus, leurs vices, et quand enfin il les rendait à la société qui les lui avait confiés, il pouvait dire sur quels hommes elle pouvait compter. Ses élèves demeuraient ses amis, et tous se faisaient un devoir de le consulter dans les grandes occasions de la vie et de suivre son avis. Voltaire fut de leur nombre, et le père Porée, qui avait deviné et encouragé ses premiers succès, disait parfois, en entendant parler de son irréligion : « C’est ma gloire et ma honte ». Mais au fond de lui, il aimait trop les talents littéraires et il en était trop bon juge pour ne pas être flatté d’avoir contribué à ceux d’un tel élève. On cite souvent la lettre écrite par Voltaire après la mort du père Porée, et où le disciple fait de son maître cet éloge : « Rien n’effacera dans mon cœur la mémoire du père Porée, qui est également chère à tous ceux qui ont étudié sous lui. Jamais homme ne rendit l’étude et la vertu plus aimable. Les heures de ses leçons étaient pour nous des heures délicieuses, et j’aurais voulu qu’il eût été établi 1 dans Paris comme dans Athènes que l’on pût assister à tout âge à de telles leçons. Je serais revenu souvent les entendre… Enfin, pendant les sept années que j’ai vécu en [son collège], qu’ai-je vu chez [lui] ? La vie la plus laborieuse, la plus frugale, la plus réglée. Toutes ses heures partagées entre les soins qu’[il] nous donnait et les exercices de sa profession austère »
le père Porée, « “De theatro”, Discours sur les spectacles »

éd. Société de littératures classiques, coll. des Rééditions de textes du XVIIe siècle, Toulouse
Il s’agit du « Discours sur les spectacles » (« De theatro ») du père Charles Porée, jésuite français d’expression latine, le professeur le plus admiré de son temps (XVIIIe siècle). Le professorat ne fut jamais pour le père Porée ce qu’il était pour la plupart de ses collègues — un passe-temps provisoire, destiné à occuper le religieux pendant ses premières années de sacerdoce. On trouve au contraire en sa personne un modèle de ces pédagogues perpétuels, ces « magistri perpetui », qui se vouent pour la vie à l’éducation de la jeunesse, sans chercher d’autre emploi pour les facultés de leur esprit. Sitôt sa formation religieuse terminée, le père Porée fut chargé d’une classe ; quarante-huit ans après, quand la mort vint le surprendre, elle le trouva encore à son poste au collège Louis-le-Grand. Durant toutes ces décennies, il ne sortit presque jamais du collège, tranchant ainsi avec les habitudes mondaines des Bouhours, des Rapin, des La Rue, dont il se montra pourtant le digne successeur. Non seulement il enseignait l’amour des belles-lettres à ses élèves, mais encore il vivait avec eux, il démêlait leurs dispositions, il parlait à leur cœur, il savait à l’avance leurs vertus, leurs vices, et quand enfin il les rendait à la société qui les lui avait confiés, il pouvait dire sur quels hommes elle pouvait compter. Ses élèves demeuraient ses amis, et tous se faisaient un devoir de le consulter dans les grandes occasions de la vie et de suivre son avis. Voltaire fut de leur nombre, et le père Porée, qui avait deviné et encouragé ses premiers succès, disait parfois, en entendant parler de son irréligion : « C’est ma gloire et ma honte ». Mais au fond de lui, il aimait trop les talents littéraires et il en était trop bon juge pour ne pas être flatté d’avoir contribué à ceux d’un tel élève. On cite souvent la lettre écrite par Voltaire après la mort du père Porée, et où le disciple fait de son maître cet éloge : « Rien n’effacera dans mon cœur la mémoire du père Porée, qui est également chère à tous ceux qui ont étudié sous lui. Jamais homme ne rendit l’étude et la vertu plus aimable. Les heures de ses leçons étaient pour nous des heures délicieuses, et j’aurais voulu qu’il eût été établi 1 dans Paris comme dans Athènes que l’on pût assister à tout âge à de telles leçons. Je serais revenu souvent les entendre… Enfin, pendant les sept années que j’ai vécu en [son collège], qu’ai-je vu chez [lui] ? La vie la plus laborieuse, la plus frugale, la plus réglée. Toutes ses heures partagées entre les soins qu’[il] nous donnait et les exercices de sa profession austère »
le père Porée, « Discours sur la satire »

éd. H. Champion, coll. L’Âge des lumières, Paris
Il s’agit du « Discours sur la satire » (« De satyra ») du père Charles Porée, jésuite français d’expression latine, le professeur le plus admiré de son temps (XVIIIe siècle). Le professorat ne fut jamais pour le père Porée ce qu’il était pour la plupart de ses collègues — un passe-temps provisoire, destiné à occuper le religieux pendant ses premières années de sacerdoce. On trouve au contraire en sa personne un modèle de ces pédagogues perpétuels, ces « magistri perpetui », qui se vouent pour la vie à l’éducation de la jeunesse, sans chercher d’autre emploi pour les facultés de leur esprit. Sitôt sa formation religieuse terminée, le père Porée fut chargé d’une classe ; quarante-huit ans après, quand la mort vint le surprendre, elle le trouva encore à son poste au collège Louis-le-Grand. Durant toutes ces décennies, il ne sortit presque jamais du collège, tranchant ainsi avec les habitudes mondaines des Bouhours, des Rapin, des La Rue, dont il se montra pourtant le digne successeur. Non seulement il enseignait l’amour des belles-lettres à ses élèves, mais encore il vivait avec eux, il démêlait leurs dispositions, il parlait à leur cœur, il savait à l’avance leurs vertus, leurs vices, et quand enfin il les rendait à la société qui les lui avait confiés, il pouvait dire sur quels hommes elle pouvait compter. Ses élèves demeuraient ses amis, et tous se faisaient un devoir de le consulter dans les grandes occasions de la vie et de suivre son avis. Voltaire fut de leur nombre, et le père Porée, qui avait deviné et encouragé ses premiers succès, disait parfois, en entendant parler de son irréligion : « C’est ma gloire et ma honte ». Mais au fond de lui, il aimait trop les talents littéraires et il en était trop bon juge pour ne pas être flatté d’avoir contribué à ceux d’un tel élève. On cite souvent la lettre écrite par Voltaire après la mort du père Porée, et où le disciple fait de son maître cet éloge : « Rien n’effacera dans mon cœur la mémoire du père Porée, qui est également chère à tous ceux qui ont étudié sous lui. Jamais homme ne rendit l’étude et la vertu plus aimable. Les heures de ses leçons étaient pour nous des heures délicieuses, et j’aurais voulu qu’il eût été établi 1 dans Paris comme dans Athènes que l’on pût assister à tout âge à de telles leçons. Je serais revenu souvent les entendre… Enfin, pendant les sept années que j’ai vécu en [son collège], qu’ai-je vu chez [lui] ? La vie la plus laborieuse, la plus frugale, la plus réglée. Toutes ses heures partagées entre les soins qu’[il] nous donnait et les exercices de sa profession austère »