Il s’agit de « Daniel Valgraive » de Joseph-Henri Rosny. Sous le pseudonyme de Rosny se masque la collaboration littéraire entre deux frères : Joseph-Henri-Honoré Boëx et Séraphin-Justin-François Boëx. Ils naquirent, l’aîné en 1856, le jeune en 1859, d’une famille française, hollandaise et espagnole installée en Belgique. Ces origines diverses, leur instinct de curiosité, un âpre amour de la lutte — les Rosny étaient d’une rare vigueur musculaire —, leur hantise de la préhistoire, et jusque la fascination qu’exerçaient sur eux les terres inhospitalières et sauvages, firent naître chez eux le rêve de rejoindre les tribus indiennes qui hantaient encore les étendues lointaines du Canada. Londres d’abord et Paris ensuite n’étaient dans leur tête qu’une escale ; mais le destin les y fixa pour la vie et fit d’eux des prisonniers de ces villes tentaculaires que les Rosny allaient fouiller en profondeur, avec toute la passion que suscitent des contrées inconnues, des contrées humaines et brutales. Ils pénétrèrent dans les faubourgs sordides ; ils connurent les fournaises, les usines, les fabriques farouches et repoussantes, crachant leurs noires fumées dans le ciel, les dépotoirs à perte de vue, autour desquels grouillaient des hommes de fer et de feu. Cette vision exaltait les Rosny jusqu’aux larmes : « Le front contre sa vitre, il contemplait le faubourg sinistre, les hautes cheminées d’usine, avec l’impression d’une tuerie lente et invincible. Aurait-on le temps de sauver les hommes ?… De vastes espérances balayaient cette crainte » 1. À jamais égarés des horizons canadiens, les Rosny se consolèrent en créant une poétique des banlieues, à laquelle on doit leurs meilleures pages. L’impression qu’un autre tire d’une forêt vierge, d’une savane, d’une jungle, d’un abîme d’herbes, de ramures et de fauves, ils la tirèrent, aussi vierge, de l’étrange remous de la civilisation industrielle. Le sifflement des sirènes, le retentissement des enclumes, la rumeur des foules devint pour eux un bruit aussi religieux que l’appel des cloches. L’aspect féroce, puissant des travailleurs, à la sortie des ateliers, leur évoqua les temps primitifs où les premiers hommes se débattaient dans des combats violents contre les forces élémentaires de la nature. Dans leurs romans aux décors suburbains, qui rejoignent d’ailleurs leurs récits préhistoriques et scientifiques, puisqu’ils se penchent sur « tout l’antique mystère » 2 des devenirs de la vie — dans leurs romans, dis-je, les Rosny font voir que « la forêt vierge et les grandes industries ne sont pas des choses opposées, ce sont des choses analogues » ; qu’un « morceau de Paris, où s’entasse la grandeur de nos semblables, doit faire palpiter les artistes autant que la chute du Rhin à Schaffhouse » 3 ; que l’œuvre des hommes est non moins belle et monstrueuse que celle de la nature — ou plutôt, il est impossible de séparer l’une de l’autre.
 Ouvrages peu soignés ou mal finis
Ouvrages peu soignés ou mal finis
Rosny, « Les Âmes perdues »
Il s’agit des « Âmes perdues » de Joseph-Henri Rosny. Sous le pseudonyme de Rosny se masque la collaboration littéraire entre deux frères : Joseph-Henri-Honoré Boëx et Séraphin-Justin-François Boëx. Ils naquirent, l’aîné en 1856, le jeune en 1859, d’une famille française, hollandaise et espagnole installée en Belgique. Ces origines diverses, leur instinct de curiosité, un âpre amour de la lutte — les Rosny étaient d’une rare vigueur musculaire —, leur hantise de la préhistoire, et jusque la fascination qu’exerçaient sur eux les terres inhospitalières et sauvages, firent naître chez eux le rêve de rejoindre les tribus indiennes qui hantaient encore les étendues lointaines du Canada. Londres d’abord et Paris ensuite n’étaient dans leur tête qu’une escale ; mais le destin les y fixa pour la vie et fit d’eux des prisonniers de ces villes tentaculaires que les Rosny allaient fouiller en profondeur, avec toute la passion que suscitent des contrées inconnues, des contrées humaines et brutales. Ils pénétrèrent dans les faubourgs sordides ; ils connurent les fournaises, les usines, les fabriques farouches et repoussantes, crachant leurs noires fumées dans le ciel, les dépotoirs à perte de vue, autour desquels grouillaient des hommes de fer et de feu. Cette vision exaltait les Rosny jusqu’aux larmes : « Le front contre sa vitre, il contemplait le faubourg sinistre, les hautes cheminées d’usine, avec l’impression d’une tuerie lente et invincible. Aurait-on le temps de sauver les hommes ?… De vastes espérances balayaient cette crainte » 1. À jamais égarés des horizons canadiens, les Rosny se consolèrent en créant une poétique des banlieues, à laquelle on doit leurs meilleures pages. L’impression qu’un autre tire d’une forêt vierge, d’une savane, d’une jungle, d’un abîme d’herbes, de ramures et de fauves, ils la tirèrent, aussi vierge, de l’étrange remous de la civilisation industrielle. Le sifflement des sirènes, le retentissement des enclumes, la rumeur des foules devint pour eux un bruit aussi religieux que l’appel des cloches. L’aspect féroce, puissant des travailleurs, à la sortie des ateliers, leur évoqua les temps primitifs où les premiers hommes se débattaient dans des combats violents contre les forces élémentaires de la nature. Dans leurs romans aux décors suburbains, qui rejoignent d’ailleurs leurs récits préhistoriques et scientifiques, puisqu’ils se penchent sur « tout l’antique mystère » 2 des devenirs de la vie — dans leurs romans, dis-je, les Rosny font voir que « la forêt vierge et les grandes industries ne sont pas des choses opposées, ce sont des choses analogues » ; qu’un « morceau de Paris, où s’entasse la grandeur de nos semblables, doit faire palpiter les artistes autant que la chute du Rhin à Schaffhouse » 3 ; que l’œuvre des hommes est non moins belle et monstrueuse que celle de la nature — ou plutôt, il est impossible de séparer l’une de l’autre.
Rosny, « La Luciole : roman »
Il s’agit de « La Luciole » de Joseph-Henri Rosny. Sous le pseudonyme de Rosny se masque la collaboration littéraire entre deux frères : Joseph-Henri-Honoré Boëx et Séraphin-Justin-François Boëx. Ils naquirent, l’aîné en 1856, le jeune en 1859, d’une famille française, hollandaise et espagnole installée en Belgique. Ces origines diverses, leur instinct de curiosité, un âpre amour de la lutte — les Rosny étaient d’une rare vigueur musculaire —, leur hantise de la préhistoire, et jusque la fascination qu’exerçaient sur eux les terres inhospitalières et sauvages, firent naître chez eux le rêve de rejoindre les tribus indiennes qui hantaient encore les étendues lointaines du Canada. Londres d’abord et Paris ensuite n’étaient dans leur tête qu’une escale ; mais le destin les y fixa pour la vie et fit d’eux des prisonniers de ces villes tentaculaires que les Rosny allaient fouiller en profondeur, avec toute la passion que suscitent des contrées inconnues, des contrées humaines et brutales. Ils pénétrèrent dans les faubourgs sordides ; ils connurent les fournaises, les usines, les fabriques farouches et repoussantes, crachant leurs noires fumées dans le ciel, les dépotoirs à perte de vue, autour desquels grouillaient des hommes de fer et de feu. Cette vision exaltait les Rosny jusqu’aux larmes : « Le front contre sa vitre, il contemplait le faubourg sinistre, les hautes cheminées d’usine, avec l’impression d’une tuerie lente et invincible. Aurait-on le temps de sauver les hommes ?… De vastes espérances balayaient cette crainte » 1. À jamais égarés des horizons canadiens, les Rosny se consolèrent en créant une poétique des banlieues, à laquelle on doit leurs meilleures pages. L’impression qu’un autre tire d’une forêt vierge, d’une savane, d’une jungle, d’un abîme d’herbes, de ramures et de fauves, ils la tirèrent, aussi vierge, de l’étrange remous de la civilisation industrielle. Le sifflement des sirènes, le retentissement des enclumes, la rumeur des foules devint pour eux un bruit aussi religieux que l’appel des cloches. L’aspect féroce, puissant des travailleurs, à la sortie des ateliers, leur évoqua les temps primitifs où les premiers hommes se débattaient dans des combats violents contre les forces élémentaires de la nature. Dans leurs romans aux décors suburbains, qui rejoignent d’ailleurs leurs récits préhistoriques et scientifiques, puisqu’ils se penchent sur « tout l’antique mystère » 2 des devenirs de la vie — dans leurs romans, dis-je, les Rosny font voir que « la forêt vierge et les grandes industries ne sont pas des choses opposées, ce sont des choses analogues » ; qu’un « morceau de Paris, où s’entasse la grandeur de nos semblables, doit faire palpiter les artistes autant que la chute du Rhin à Schaffhouse » 3 ; que l’œuvre des hommes est non moins belle et monstrueuse que celle de la nature — ou plutôt, il est impossible de séparer l’une de l’autre.
Rosny, « Marc Fane : roman parisien »
Il s’agit de « Marc Fane » de Joseph-Henri Rosny. Sous le pseudonyme de Rosny se masque la collaboration littéraire entre deux frères : Joseph-Henri-Honoré Boëx et Séraphin-Justin-François Boëx. Ils naquirent, l’aîné en 1856, le jeune en 1859, d’une famille française, hollandaise et espagnole installée en Belgique. Ces origines diverses, leur instinct de curiosité, un âpre amour de la lutte — les Rosny étaient d’une rare vigueur musculaire —, leur hantise de la préhistoire, et jusque la fascination qu’exerçaient sur eux les terres inhospitalières et sauvages, firent naître chez eux le rêve de rejoindre les tribus indiennes qui hantaient encore les étendues lointaines du Canada. Londres d’abord et Paris ensuite n’étaient dans leur tête qu’une escale ; mais le destin les y fixa pour la vie et fit d’eux des prisonniers de ces villes tentaculaires que les Rosny allaient fouiller en profondeur, avec toute la passion que suscitent des contrées inconnues, des contrées humaines et brutales. Ils pénétrèrent dans les faubourgs sordides ; ils connurent les fournaises, les usines, les fabriques farouches et repoussantes, crachant leurs noires fumées dans le ciel, les dépotoirs à perte de vue, autour desquels grouillaient des hommes de fer et de feu. Cette vision exaltait les Rosny jusqu’aux larmes : « Le front contre sa vitre, il contemplait le faubourg sinistre, les hautes cheminées d’usine, avec l’impression d’une tuerie lente et invincible. Aurait-on le temps de sauver les hommes ?… De vastes espérances balayaient cette crainte » 1. À jamais égarés des horizons canadiens, les Rosny se consolèrent en créant une poétique des banlieues, à laquelle on doit leurs meilleures pages. L’impression qu’un autre tire d’une forêt vierge, d’une savane, d’une jungle, d’un abîme d’herbes, de ramures et de fauves, ils la tirèrent, aussi vierge, de l’étrange remous de la civilisation industrielle. Le sifflement des sirènes, le retentissement des enclumes, la rumeur des foules devint pour eux un bruit aussi religieux que l’appel des cloches. L’aspect féroce, puissant des travailleurs, à la sortie des ateliers, leur évoqua les temps primitifs où les premiers hommes se débattaient dans des combats violents contre les forces élémentaires de la nature. Dans leurs romans aux décors suburbains, qui rejoignent d’ailleurs leurs récits préhistoriques et scientifiques, puisqu’ils se penchent sur « tout l’antique mystère » 2 des devenirs de la vie — dans leurs romans, dis-je, les Rosny font voir que « la forêt vierge et les grandes industries ne sont pas des choses opposées, ce sont des choses analogues » ; qu’un « morceau de Paris, où s’entasse la grandeur de nos semblables, doit faire palpiter les artistes autant que la chute du Rhin à Schaffhouse » 3 ; que l’œuvre des hommes est non moins belle et monstrueuse que celle de la nature — ou plutôt, il est impossible de séparer l’une de l’autre.
Jesuthasan, « Shoba, itinéraire d’un réfugié »
Il s’agit de « Shoba, itinéraire d’un réfugié », autobiographie de M. Antonythasan Jesuthasan 1, acteur et auteur d’expression tamoule et française, engagé à l’adolescence dans le mouvement des Tigres tamouls, exilé en France. Il naquit en 1967 au village d’Allaipiddy 2, tout au Nord du Sri Lanka, près de Jaffna. C’était un lieu paisible cerné par les rizières et les forêts. « Les gamins de trois ou quatre ans se promenaient seuls dans la rue ; ils ne risquaient rien, car tout le monde se connaissait et tout le monde savait qui était le fils de qui. » 3 En 1979, notre gamin comprit qu’une guerre civile, quelque grand malheur couvait sous la cendre. La police cinghalaise venait d’arrêter deux séparatistes tamouls, de les torturer, puis de jeter leurs cadavres décapités sur le bord de la route. Au matin, M. Jesuthasan vit tout le village y accourir. « Aujourd’hui encore, je me rappelle les noms de ces deux rebelles : Inpam et Selvam… J’avais alors douze ans, et mon enfance s’achevait brutalement. » 4 En 1981, une autre émeute anti-tamoule éclata. La bibliothèque de Jaffna dont les flèches majestueuses étaient visibles depuis le village, fut incendiée par la police et les émeutiers en représailles de l’assassinat de deux policiers. Le feu emporta 95 000 ouvrages, parmi lesquels des manuscrits sur feuilles de palmier n’existant nulle part ailleurs et perdus sans retour pour l’humanité. « Tout le monde avait peur. L’atmosphère était très tendue. Nous étions si près de Jaffna, et la petite bande de mer qui nous [en] séparait semblait rétrécir de jour en jour. Et si les émeutiers franchissaient le pont ?… Les militaires étaient les pires : certains jours, à Jaffna, ils passaient en voiture et mitraillaient la foule au hasard. » Puis, il y eut juillet 1983. « Juillet noir ». Les Tigres tamouls, constitués en résistance armée, venaient de tuer treize militaires lors d’une attaque. Tandis que les corps étaient rapatriés, le gouvernement cinghalais décrétait le couvre-feu à Colombo et dans la province du Nord, qu’il livrait à la vindicte populaire. Durant les semaines suivantes, des foules déchaînées s’en prenaient aux Tamouls, brûlant leurs habitations, leurs commerces, leurs voitures. Combien de victimes ? L’ambassade d’Allemagne signalait 1 500 tués ; les estimations « officielles » — 371 tués et 100 000 autres sans abri 5. Et voilà qui acheva de convaincre les indécis à embrasser la cause des Tigres tamouls. M. Jesuthasan en fut. Il quitta sa maison en pleine nuit, comme un voleur, laissant seulement ces quelques mots d’adieu : « Je vais me battre pour mon peuple ».
- En tamoul அன்ரனிதாசன் யேசுதாசன். Également connu sous le surnom de Shoba Sakthi (ஷோபா சக்தி).
- En tamoul அல்லைப்பிட்டி.
- « Shoba, itinéraire d’un réfugié », p. 11.
- id. p. 27.
- « Résumé par le requérant de la situation politique au Sri Lanka » dans Commission européenne des droits de l’homme (Cour européenne des droits de l’homme), « Décisions et Rapports », vol. 52.
Jesuthasan, « Friday et Friday : nouvelles »
Il s’agit du « Chevalier de Kandy » (« Kandy Veeran » 1) et autres nouvelles de M. Antonythasan Jesuthasan 2, acteur et auteur d’expression tamoule et française, engagé à l’adolescence dans le mouvement des Tigres tamouls, exilé en France. Il naquit en 1967 au village d’Allaipiddy 3, tout au Nord du Sri Lanka, près de Jaffna. C’était un lieu paisible cerné par les rizières et les forêts. « Les gamins de trois ou quatre ans se promenaient seuls dans la rue ; ils ne risquaient rien, car tout le monde se connaissait et tout le monde savait qui était le fils de qui. » 4 En 1979, notre gamin comprit qu’une guerre civile, quelque grand malheur couvait sous la cendre. La police cinghalaise venait d’arrêter deux séparatistes tamouls, de les torturer, puis de jeter leurs cadavres décapités sur le bord de la route. Au matin, M. Jesuthasan vit tout le village y accourir. « Aujourd’hui encore, je me rappelle les noms de ces deux rebelles : Inpam et Selvam… J’avais alors douze ans, et mon enfance s’achevait brutalement. » 5 En 1981, une autre émeute anti-tamoule éclata. La bibliothèque de Jaffna dont les flèches majestueuses étaient visibles depuis le village, fut incendiée par la police et les émeutiers en représailles de l’assassinat de deux policiers. Le feu emporta 95 000 ouvrages, parmi lesquels des manuscrits sur feuilles de palmier n’existant nulle part ailleurs et perdus sans retour pour l’humanité. « Tout le monde avait peur. L’atmosphère était très tendue. Nous étions si près de Jaffna, et la petite bande de mer qui nous [en] séparait semblait rétrécir de jour en jour. Et si les émeutiers franchissaient le pont ?… Les militaires étaient les pires : certains jours, à Jaffna, ils passaient en voiture et mitraillaient la foule au hasard. » Puis, il y eut juillet 1983. « Juillet noir ». Les Tigres tamouls, constitués en résistance armée, venaient de tuer treize militaires lors d’une attaque. Tandis que les corps étaient rapatriés, le gouvernement cinghalais décrétait le couvre-feu à Colombo et dans la province du Nord, qu’il livrait à la vindicte populaire. Durant les semaines suivantes, des foules déchaînées s’en prenaient aux Tamouls, brûlant leurs habitations, leurs commerces, leurs voitures. Combien de victimes ? L’ambassade d’Allemagne signalait 1 500 tués ; les estimations « officielles » — 371 tués et 100 000 autres sans abri 6. Et voilà qui acheva de convaincre les indécis à embrasser la cause des Tigres tamouls. M. Jesuthasan en fut. Il quitta sa maison en pleine nuit, comme un voleur, laissant seulement ces quelques mots d’adieu : « Je vais me battre pour mon peuple ».
- En tamoul « கண்டி வீரன் ». Parfois transcrit « Kandi Veeran ».
- En tamoul அன்ரனிதாசன் யேசுதாசன். Également connu sous le surnom de Shoba Sakthi (ஷோபா சக்தி).
- En tamoul அல்லைப்பிட்டி.
- « Shoba, itinéraire d’un réfugié », p. 11.
- id. p. 27.
- « Résumé par le requérant de la situation politique au Sri Lanka » dans Commission européenne des droits de l’homme (Cour européenne des droits de l’homme), « Décisions et Rapports », vol. 52.
Der Alexanian, « Des choses à vivre, une histoire française : roman »
Il s’agit de « Des choses à vivre, une histoire française », roman de M. Jacques Der Alexanian 1. Jetés hors de leur pays, les parents de M. Der Alexanian avaient été accueillis en France et y avaient refait leur vie. Comme tous ceux de leur génération, ils ne vivaient pas totalement heureux, et pas tristes non plus, avec quelque chose en eux qui restait inconsolable. Le souvenir de leur patrie n’avait cessé de les poursuivre. Là où ils situaient le paradis terrestre ; là où se dressaient jadis les magnifiques monuments de la chrétienté ; dans cette contrée que les dépêches appelaient l’Anatolie orientale, et qui était l’Arménie, il n’y avait plus aucun Arménien. Ses villages avaient été débaptisés, ses étymologies trahies, ses gens tués ou déportés, ses monastères pervertis en prisons et ne tenant encore debout que pour rappeler cette page honteuse et sanglante au livre de l’histoire turque. Il ne se passait pas de semaine à la maison Der Alexanian sans visite de parents ou de voisins arméniens pour raconter les drames auxquels ils avaient été mêlés. M. Der Alexanian demeurait, notamment, frappé par l’une des proches amies de ses parents. Par des allusions, par des demi-mots, cette femme en apparence si calme laissait entendre qu’elle avait dû subir, toute jeune fille, les pires atrocités. Dépouillée de tous ses vêtements, battue, violentée par les Turcs, elle avait été laissée pour morte. Par quel miracle avait-elle survécu ? Toujours est-il qu’elle avait erré des semaines, des mois durant à travers des montagnes sauvages, vivant d’herbes, de racines et de baies. Les parents de M. Der Alexanian, Gazaros 2 et Nevarte, eux, parlaient peu ; ou ils parlaient seulement de la France et de tout le respect que leur inspirait cette seconde patrie, disant quelquefois, avec M. Charles Aznavour : « La France c’est mon pays, l’Arménie c’est ma religion » 3.
Der Alexanian, « Il s’est écoulé un siècle : roman »
Il s’agit d’« Il s’est écoulé un siècle », roman de M. Jacques Der Alexanian 1. Jetés hors de leur pays, les parents de M. Der Alexanian avaient été accueillis en France et y avaient refait leur vie. Comme tous ceux de leur génération, ils ne vivaient pas totalement heureux, et pas tristes non plus, avec quelque chose en eux qui restait inconsolable. Le souvenir de leur patrie n’avait cessé de les poursuivre. Là où ils situaient le paradis terrestre ; là où se dressaient jadis les magnifiques monuments de la chrétienté ; dans cette contrée que les dépêches appelaient l’Anatolie orientale, et qui était l’Arménie, il n’y avait plus aucun Arménien. Ses villages avaient été débaptisés, ses étymologies trahies, ses gens tués ou déportés, ses monastères pervertis en prisons et ne tenant encore debout que pour rappeler cette page honteuse et sanglante au livre de l’histoire turque. Il ne se passait pas de semaine à la maison Der Alexanian sans visite de parents ou de voisins arméniens pour raconter les drames auxquels ils avaient été mêlés. M. Der Alexanian demeurait, notamment, frappé par l’une des proches amies de ses parents. Par des allusions, par des demi-mots, cette femme en apparence si calme laissait entendre qu’elle avait dû subir, toute jeune fille, les pires atrocités. Dépouillée de tous ses vêtements, battue, violentée par les Turcs, elle avait été laissée pour morte. Par quel miracle avait-elle survécu ? Toujours est-il qu’elle avait erré des semaines, des mois durant à travers des montagnes sauvages, vivant d’herbes, de racines et de baies. Les parents de M. Der Alexanian, Gazaros 2 et Nevarte, eux, parlaient peu ; ou ils parlaient seulement de la France et de tout le respect que leur inspirait cette seconde patrie, disant quelquefois, avec M. Charles Aznavour : « La France c’est mon pays, l’Arménie c’est ma religion » 3.
Sun Bin, « Le Traité militaire »

éd. Institut de stratégie comparée-Economica, coll. Bibliothèque stratégique, Paris
Il s’agit des « Sept Traités de la guerre » 1 (« Wu jing qi shu » 2), où se concentre l’essence de la pensée stratégique de la Chine ancienne : 1º « Art de la guerre de Sun zi [ou Sun tzu] » 3 (« Sun zi bing fa » 4) ; 2º « Art de la guerre de Wu zi » 5 (« Wu zi bing fa » 6) ; 3º « Art des maréchaux » 7 (« Si ma fa » 8) ; 4º « Maître Wei Liao » 9 (« Wei Liao zi » 10) ; 5º « Stratégie en trois chapitres » 11 (« San Lüe » 12) ; 6º « Six Fourreaux » 13 (« Liu Tao » 14) ; 7º « Dialogue avec Li, duc de Wei » 15 (« Li Wei gong wen dui » 16). On pourrait y ajouter l’« Art de la guerre de Sun Bin » (« Sun Bin bing fa » 17), ouvrage longtemps perdu, puis redécouvert récemment dans une tombe à Yinqueshan. En Occident comme en Chine, c’est le premier des « Sept Traités », et le plus ancien (Ve siècle av. J.-C.), qui est resté le plus fameux : « Art de la guerre de Sun tzu ». Général du roi de Wu 18, Sun tzu aurait obtenu ce poste à la suite d’un fort bel exploit : il aurait créé un corps d’élite féminin, un régiment composé des cent quatre-vingts femmes les plus délicates du palais, que le roi lui aurait confiées pour éprouver ses dons de stratège. « Les Sept Traités de la guerre » sont unanimes à regarder la guerre comme une calamité. On ne l’entreprend que contraint et forcé. La guerre est pour le pays ce qu’une violente maladie est pour le corps. La paix en est la guérison. La nécessité seule doit nous pousser au combat. Encore faut-il épuiser auparavant toutes les ressources de la ruse et de la médiation. Quant au combat lui-même, la sagesse consiste à le mener avec grande retenue, avec « charité », et à y mettre fin le plus tôt qu’il se peut. Le premier chapitre de l’« Art des maréchaux » est intitulé justement « La charité pour fondement ». Il adresse les recommandations suivantes à l’armée qui s’apprêterait à combattre : « Lorsque vous entrerez sur le territoire du coupable, vous ne devez ni profaner ses dieux… ni détruire ses ouvrages d’art, ni brûler ses maisons, ni abattre ses forêts, ni faire main basse sur ses troupeaux, ses récoltes et ses outils. Vous laisserez aller les enfants et les vieillards sans les molester ; vous ne porterez pas la main sur les hommes valides que vous croiserez en chemin, à moins qu’ils ne fassent mine de résister ». Sun tzu le dit aussi en ses propres termes : « Il est préférable de préserver un pays [que de] le détruire… Être victorieux dans tous les combats n’est pas le fin du fin. Soumettre l’ennemi sans ensanglanter la lame, voilà le fin du fin ».
- Parfois traduit « Sept Classiques de l’art de la guerre » ou « Les Sept Classiques militaires ».
- En chinois « 武經七書 ». Autrefois transcrit « Wu-ching ch’i-shu ».
- Parfois traduit « L’Art de la guerre selon maître Sun », « Les Treize Articles sur l’art militaire par Sun-tsée », « Méthode stratégique de maître Sun », « Règles de l’art militaire par Sun-tse », « L’Art militaire de Souen tseu », « Art de faire la guerre du maître Sun » ou « L’Art de la guerre de maître Sun ou Sun-tzu ».
- En chinois « 孫子兵法 ». Parfois transcrit « Sun-tse-ping-fa », « Sun tze ping fa », « Sun tzu ping fa » ou « Souen-tseu ping-fa ».
- Autrefois traduit « Le Traité militaire de Wu », « Les Six Articles sur l’art militaire par Ou-tse » ou « Le Traité militaire de maître Wou ou Wou-tseu ».
- En chinois « 吳子兵法 ». Autrefois transcrit « Ou-tse-ping-fa » ou « Wu tzu ping fa ».
- Parfois traduit « Les Quatre Articles sur l’art militaire par Se-ma », « Les Principes du Sema », « Le Code militaire du grand maréchal » ou « Les Règles stratégiques du grand maréchal ».
- En chinois « 司馬法 ». Parfois transcrit « Se-ma-fa », « Sse-ma-fa » ou « Ssu-ma fa ».
- Parfois traduit « Art du commandement de Liao » ou « L’Art du commandement du commandant Leao ».
- En chinois « 尉繚子 ». Autrefois transcrit « Goei-Leao-tse », « Wei Liao tzu » ou « Wei-Leao-tseu ».
- Autrefois traduit « Les Trois Stratégies » ou « Trois Ordres stratégiques ».
- En chinois « 三略 ». Parfois transcrit « San-lio », « San lüeh » ou « San-liue ».
- Autrefois traduit « Les Six Arcanes stratégiques ».
- En chinois « 六韜 ». Parfois transcrit « Liu Thao », « Lou-tao » ou « Lieou T’ao ».
- Autrefois traduit « Questions de l’Empereur des T’ang au général Li Wei-kong », « Les Questions de l’Empereur Taizong des Tang au général Li Jing » ou « Questions et Réponses entre Li Wei-kong et l’Empereur des T’ang ».
- En chinois « 李衛公問對 ». Parfois transcrit « Li Wei-kong wen-touei » ou « Li Wei kung wên tui ». Également connu sous les titres de « Tang Li wen dui » (« 唐李問對 »), c’est-à-dire « Dialogue entre Tang et Li », et « Tang Tai zong Li Jing wen dui » (« 唐太宗李靖問對 »), c’est-à-dire « Dialogue entre Tai zong des Tang et Li Jing ». Parfois transcrit « T’ang Li wen-touei ».
- En chinois « 孫臏兵法 ». Autrefois transcrit « Sun Pin ping-fa ».
- Le roi Helu (闔廬).
Ji Kang, « Se délivrer des sentiments personnels »
![dans « La Vie et la Pensée de Hi K’ang [ou Ji Kang] (223-262 apr. J.-C.) », éd. E. J. Brill, Leyde, p. 122-130](https://www.notesdumontroyal.com/image/1073-256x400.webp)
dans « La Vie et la Pensée de Hi K’ang [ou Ji Kang] (223-262 apr. J.-C.) », éd. E. J. Brill, Leyde, p. 122-130
Il s’agit de « Se délivrer des sentiments personnels » 1 (« Shisi lun » 2) de Ji Kang 3, virtuose de la cithare, fervent taoïste, poète attachant par ses opinions et ses manières de voir autant que par son talent, chef de file des « Sept Sages du bosquet de bambous » (fameux cénacle dont je parlerai ailleurs). Fier, indépendant, Ji Kang était un homme de la haute société, époux d’une princesse, mais alliant un amour mystique, presque religieux, de la nature et un profond dégoût pour les règles et les idées reçues. Il proclamait haut et fort, seize siècles avant Flaubert dans sa « Correspondance » 4, que « les honneurs déshonorent ; le titre dégrade ; la fonction abrutit ». Dans sa « Lettre de rupture avec Shan Tao », il confiait que l’éducation libertaire qu’il a reçue dans son enfance a fait de lui « un cerf sauvage » qui devient comme fou à la vue des liens rigides que porte au cou tout fonctionnaire en poste : « Un cerf sauvage se pliera à ce qu’on lui a inculqué, pourvu qu’on l’ait capturé et pris en main encore jeune. Mais qu’on lui passe la bride, une fois adulte, et il se débattra comme un dément, pour faire voler ses liens, quitte à ruer dans les flammes ou l’eau bouillante ». Ji Kang se jugeait, en somme, totalement inapte au service mandarinal. Aux yeux de ses contemporains, pour un homme de sa classe et de sa condition, c’était un véritable crime de ne pas être fonctionnaire — un crime non seulement contre la tradition, mais contre les assises mêmes de l’autorité confucianiste. Ji Kang s’en rendait compte, mais son esprit excentrique et rebelle l’entraînait irrésistiblement vers la poésie, la musique céleste, les ébats dans la nature, les promenades heureuses au cours desquelles il se perdait au point d’oublier le retour. La légende se plaît à le représenter vagabondant dans le bosquet de bambous de Shanyang où il réunissait ses amis, tous plus bizarres les uns que les autres, recherchant des plantes dont il préparait des drogues d’immortalité, et « se nourrissant des vapeurs roses de l’aurore » (« can xia » 5).
- Parfois traduit « Essai sur la déprise de l’ego », « Traité sur la déprise du moi » ou « Se délivrer du moi ».
- En chinois « 釋私論 ». Autrefois transcrit « Shih-ssû-lun », « Shih-tzu-lun » ou « Che sseu louen ».
- En chinois 嵇康. Parfois transcrit Xi Kang, Ki Kang, Chi K’ang, Tsi K’ang, Hsi K’ang, Hi K’ang ou Si K’ang.
Doubnov, « Précis d’histoire juive : des origines à nos jours [complété par Marc Jarblum] »

éd. Service technique pour l’éducation, Paris
Il s’agit du « Précis d’histoire juive », ou littéralement « L’Histoire juive racontée aux enfants » (« Yidishe Geshikhte dertseylt far Kinder » 1) de Simon Doubnov 2, l’un des plus éminents historiens juifs (XIXe-XXe siècle). La vie de cet historiographe, né du temps des pogromes russes et mort dans les camps de la barbarie nazie, est celle de toute une génération de Juifs de l’Europe orientale. Qu’au milieu du carnage et « du fond du gouffre », comme il dit lui-même 3, cet homme ait songé à des travaux historiques de si grande envergure, cela peut paraître étrange. Mais cela témoigne simplement de la pérennité du judaïsme, de sa vivacité dans la mort. Doubnov avait une hauteur de vues, une élévation de pensées, une piété qui l’obligeaient à chercher l’indestructible au milieu des destructions ; il disait comme Archimède au soldat romain : « Ne dérange pas mes cercles ! » « Que de fois », dit Doubnov 4, « la douleur causée par les brûlants soucis quotidiens a été apaisée par mes rêves ardents du moment où un grandiose édifice 5 s’élèverait, et où ces milliers de faits et de combinaisons se mêleraient en un vif tableau dépeignant huit cents ans de la vie de notre peuple en Europe orientale ! » Des témoins rapportent que même après son arrestation par les agents de la Gestapo, malade et grelottant de fièvre, Doubnov n’arrêta pas son travail : avec le stylo qui lui avait servi pendant tant d’années, il remplit un carnet de notes. Juste avant d’être abattu d’un coup de revolver, on le vit marchant et répétant : « Bonnes gens, n’oubliez pas, bonnes gens, racontez, bonnes gens, écrivez ! » 6 De ceux à qui s’adressaient ces paroles, presque aucun ne survécut. « Les pensées sont comme les fleurs ou les fruits, comme le blé et tout ce qui pousse et grandit de la terre. Elles ont besoin de temps et d’un lieu pour être semées, elles ont besoin d’un hiver pour prendre des forces et d’un printemps pour sortir et s’épanouir. Il y a les historiens de l’hiver et les historiens du printemps… Doubnov est un historien de l’hiver », dit M. Marc-Alain Ouaknin
- On rencontre aussi les graphies « Idishe Geshikhte dertseylt far Kinder », « Jidische Geschichte derzeilt far Kinder », « Idische Geschichte derzejlt far Kinder » et « Yiddische Geschichte derzeilt far Kinder ».
- En russe Семён Дубнов ou Шимон Дубнов. Parfois transcrit Semyon Dubnow, Simeon Dubnow, Shimeon Dubnow, Shimon Dubnov ou Semën Dubnov. Le nom de Doubnov, conformément à une pratique bien établie chez les Juifs, lui vient de la ville dont ses ancêtres étaient originaires : Doubno (Дубно), en Ukraine.
- « Le Livre de ma vie : souvenirs et réflexions, matériaux pour l’histoire de mon temps », p. 737.
- id. p. 359.
- La grandiose somme en dix volumes, « Histoire universelle du peuple juif », sur laquelle Doubnov ne cessa de travailler de 1901 jusqu’à son assassinat.
- Dans Sophie Erlich-Doubnov, « La Vie de Simon Dubnov », p. 25.
Ibn Rushd (Averroès), « La Doctrine de l’intellect matériel dans le “Commentaire moyen au ‘De anima’ d’Aristote” »

dans « Langages et Philosophie : hommage à Jean Jolivet » (éd. J. Vrin, coll. Études de philosophie médiévale, Paris), p. 281-307
Il s’agit d’une traduction partielle du « Commentaire moyen sur le traité “De l’âme” » (« Talkhîs kitâb al-nafs » 1) d’Ibn Rushd 2 (XIIe siècle apr. J.-C.). De tous les philosophes que l’islam donna à l’Espagne, celui qui laissa le plus de traces dans la mémoire des peuples, grâce à ses remarquables commentaires sur les écrits d’Aristote, fut Ibn Rushd, également connu sous les noms corrompus d’Aben-Rost, Averroïs, Averrhoës ou Averroès 3. Dans son Andalousie natale, ce coin privilégié du monde, le goût des sciences et des belles choses avait établi au Xe siècle une tolérance dont notre époque moderne peut à peine offrir un exemple. « Chrétiens, juifs, musulmans parlaient la même langue, chantaient les mêmes poésies, participaient aux mêmes études littéraires et scientifiques. Toutes les barrières qui séparent les hommes étaient tombées ; tous travaillaient d’un même accord à l’œuvre de la civilisation commune », dit Renan. Abû Ya‘ḳûb Yûsuf 4, calife de l’Andalousie et contemporain d’Ibn Rushd, fut le prince le plus lettré de son temps. L’illustre philosophe Ibn Thofaïl obtint à sa Cour une grande influence et en profita pour y attirer les savants de renom. Ce fut d’après le vœu exprimé par Yûsuf et sur les instances d’Ibn Thofaïl qu’Ibn Rushd entreprit de commenter Aristote. Jamais ce dernier n’avait reçu de soins aussi étendus, aussi sincères et dévoués que ceux que lui prodiguera Ibn Rushd. L’aristotélisme ne sera plus grec ; il sera arabe. « Mais la cause fatale qui a étouffé chez les musulmans les plus beaux germes de développement intellectuel, le fanatisme religieux, préparait déjà la ruine [de la philosophie] », dit Renan. Vers la fin du XIIe siècle, l’antipathie des imams et du peuple contre les études rationnelles se déchaîne sur toute la surface du monde musulman. Bientôt il suffira de dire d’un homme : « Un tel travaille à la philosophie ou donne des leçons d’astronomie », pour que les gens du peuple lui appliquent immédiatement le nom d’« impie », de « mécréant », etc. ; et que, si par malheur il persévère, ils le frappent dans la rue ou lui brûlent sa maison.
Ibn Rushd (Averroès), « L’Intelligence et la Pensée, [ou] Grand Commentaire du “De anima”, livre III »
Il s’agit d’une traduction partielle du « Grand Commentaire sur le traité “De l’âme” » (« Sharḥ kitâb al-nafs » 1) d’Ibn Rushd 2 (XIIe siècle apr. J.-C.). De tous les philosophes que l’islam donna à l’Espagne, celui qui laissa le plus de traces dans la mémoire des peuples, grâce à ses remarquables commentaires sur les écrits d’Aristote, fut Ibn Rushd, également connu sous les noms corrompus d’Aben-Rost, Averroïs, Averrhoës ou Averroès 3. Dans son Andalousie natale, ce coin privilégié du monde, le goût des sciences et des belles choses avait établi au Xe siècle une tolérance dont notre époque moderne peut à peine offrir un exemple. « Chrétiens, juifs, musulmans parlaient la même langue, chantaient les mêmes poésies, participaient aux mêmes études littéraires et scientifiques. Toutes les barrières qui séparent les hommes étaient tombées ; tous travaillaient d’un même accord à l’œuvre de la civilisation commune », dit Renan. Abû Ya‘ḳûb Yûsuf 4, calife de l’Andalousie et contemporain d’Ibn Rushd, fut le prince le plus lettré de son temps. L’illustre philosophe Ibn Thofaïl obtint à sa Cour une grande influence et en profita pour y attirer les savants de renom. Ce fut d’après le vœu exprimé par Yûsuf et sur les instances d’Ibn Thofaïl qu’Ibn Rushd entreprit de commenter Aristote. Jamais ce dernier n’avait reçu de soins aussi étendus, aussi sincères et dévoués que ceux que lui prodiguera Ibn Rushd. L’aristotélisme ne sera plus grec ; il sera arabe. « Mais la cause fatale qui a étouffé chez les musulmans les plus beaux germes de développement intellectuel, le fanatisme religieux, préparait déjà la ruine [de la philosophie] », dit Renan. Vers la fin du XIIe siècle, l’antipathie des imams et du peuple contre les études rationnelles se déchaîne sur toute la surface du monde musulman. Bientôt il suffira de dire d’un homme : « Un tel travaille à la philosophie ou donne des leçons d’astronomie », pour que les gens du peuple lui appliquent immédiatement le nom d’« impie », de « mécréant », etc. ; et que, si par malheur il persévère, ils le frappent dans la rue ou lui brûlent sa maison.

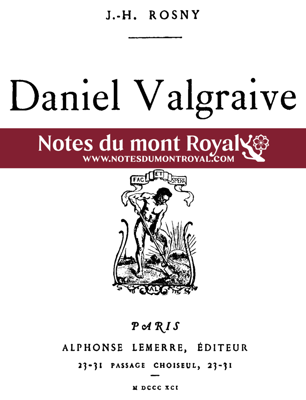
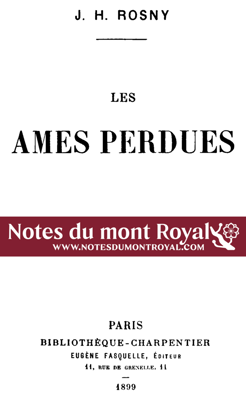
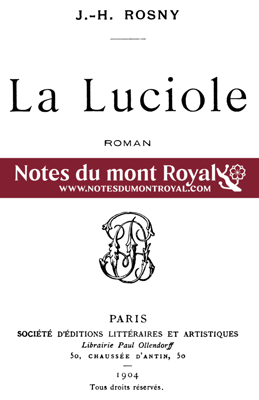











![dans « [Nouvelles japonaises]. Tome III. Les Paons, la Grenouille, le Moine-Cigale (1955-1970) » (éd. Ph. Picquier, Arles), p. 83-92](https://www.notesdumontroyal.com/image/787-200x200.webp)
