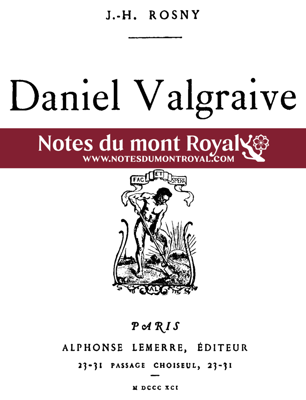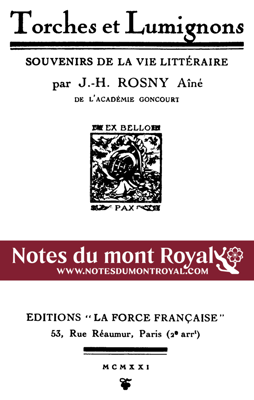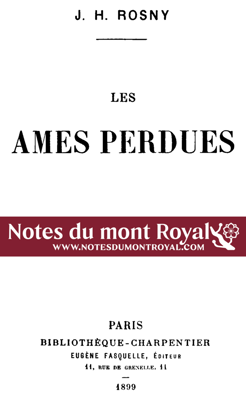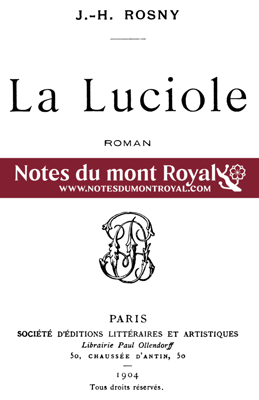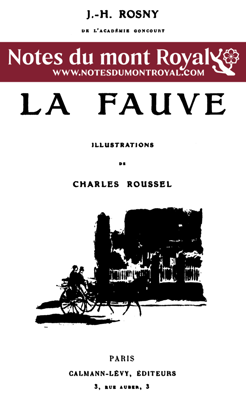
éd. Calmann-Lévy, coll. Nouvelle Collection illustrée, Paris
Il s’agit de « La Fauve » de Joseph-Henri Rosny. Sous le pseudonyme de Rosny se masque la collaboration littéraire entre deux frères : Joseph-Henri-Honoré Boëx et Séraphin-Justin-François Boëx. Ils naquirent, l’aîné en 1856, le jeune en 1859, d’une famille française, hollandaise et espagnole installée en Belgique. Ces origines diverses, leur instinct de curiosité, un âpre amour de la lutte — les Rosny étaient d’une rare vigueur musculaire —, leur hantise de la préhistoire, et jusque la fascination qu’exerçaient sur eux les terres inhospitalières et sauvages, firent naître chez eux le rêve de rejoindre les tribus indiennes qui hantaient encore les étendues lointaines du Canada. Londres d’abord et Paris ensuite n’étaient dans leur tête qu’une escale ; mais le destin les y fixa pour la vie et fit d’eux des prisonniers de ces villes tentaculaires que les Rosny allaient fouiller en profondeur, avec toute la passion que suscitent des contrées inconnues, des contrées humaines et brutales. Ils pénétrèrent dans les faubourgs sordides ; ils connurent les fournaises, les usines, les fabriques farouches et repoussantes, crachant leurs noires fumées dans le ciel, les dépotoirs à perte de vue, autour desquels grouillaient des hommes de fer et de feu. Cette vision exaltait les Rosny jusqu’aux larmes : « Le front contre sa vitre, il contemplait le faubourg sinistre, les hautes cheminées d’usine, avec l’impression d’une tuerie lente et invincible. Aurait-on le temps de sauver les hommes ?… De vastes espérances balayaient cette crainte » 1. À jamais égarés des horizons canadiens, les Rosny se consolèrent en créant une poétique des banlieues, à laquelle on doit leurs meilleures pages. L’impression qu’un autre tire d’une forêt vierge, d’une savane, d’une jungle, d’un abîme d’herbes, de ramures et de fauves, ils la tirèrent, aussi vierge, de l’étrange remous de la civilisation industrielle. Le sifflement des sirènes, le retentissement des enclumes, la rumeur des foules devint pour eux un bruit aussi religieux que l’appel des cloches. L’aspect féroce, puissant des travailleurs, à la sortie des ateliers, leur évoqua les temps primitifs où les premiers hommes se débattaient dans des combats violents contre les forces élémentaires de la nature. Dans leurs romans aux décors suburbains, qui rejoignent d’ailleurs leurs récits préhistoriques et scientifiques, puisqu’ils se penchent sur « tout l’antique mystère » 2 des devenirs de la vie — dans leurs romans, dis-je, les Rosny font voir que « la forêt vierge et les grandes industries ne sont pas des choses opposées, ce sont des choses analogues » ; qu’un « morceau de Paris, où s’entasse la grandeur de nos semblables, doit faire palpiter les artistes autant que la chute du Rhin à Schaffhouse » 3 ; que l’œuvre des hommes est non moins belle et monstrueuse que celle de la nature — ou plutôt, il est impossible de séparer l’une de l’autre.