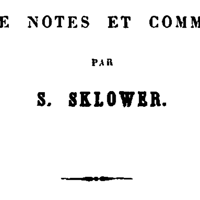éd. Les Belles Lettres, coll. des universités de France, Paris
Il s’agit des « Lettres (morales) à Lucilius » 1 (« Ad Lucilium epistulæ (morales) ») de Sénèque le philosophe 2, moraliste latin doublé d’un psychologue, dont les œuvres assez décousues, mais riches en remarques inestimables, sont « un trésor de morale et de bonne philosophie » 3. Il naquit à Cordoue vers 4 av. J.-C. Il entra, par le conseil de son père, dans la carrière du barreau, et ses débuts eurent tant d’éclat que le prince Caligula, qui avait des prétentions à l’éloquence, jaloux du bruit de sa renommée, parla de le faire mourir. Sénèque ne dut son salut qu’à sa santé chancelante, minée par les veilles studieuses à la lueur de la lampe. On rapporta à Caligula que ce jeune phtisique avait à peine le souffle, que ce serait tuer un mourant. Et Caligula se rendit à ces raisons et se contenta d’adresser à son rival des critiques quelquefois fondées, mais toujours malveillantes, appelant son style « du sable sans chaux » (« arena sine calce »), et ses discours oratoires — « de pures tirades théâtrales ». Dès lors, Sénèque ne pensa qu’à se faire oublier ; il s’adonna tout entier à la philosophie et n’eut d’autres fréquentations que des stoïciens. Cependant, son père, craignant qu’il ne se fermât l’accès aux honneurs, l’exhorta à revenir à la carrière publique et à ne pas bouder les compromissions. En 49 apr. J.-C., Sénèque se vit confier par Agrippine l’éducation de Néron. On sait ce que fut Néron. Sénèque ne pouvait pas raisonnablement espérer de faire un homme recommandable de ce sale garnement, de ce triste élève, « mal élevé, vaniteux, insolent, sensuel, hypocrite, paresseux » 4. Néron, en revanche, fit de notre auteur un « ami » forcé, un collaborateur malgré lui, le chargeant de rédiger ses allocutions au sénat, dont celle où il représentait le meurtre de sa mère Agrippine comme un bonheur inespéré pour Rome. Toutes les belles leçons, tous les bons offices de Sénèque en tant que ministre de Néron n’aboutirent qu’à retarder de quelques années l’éclosion des pires monstruosités. Alors, il chercha à échapper à ses hautes, mais déshonorantes fonctions. Il demanda de partir à la campagne, en renonçant à ses biens qui, dit-il, l’exposaient à l’envie générale. Malgré les refus de Néron, qui se rendait compte que la retraite de son ministre serait interprétée comme un désaveu de la politique impériale, Sénèque ne recula pas. « En réalité, sa vertu lui faisait habiter une autre région de l’univers ; il n’avait [plus] rien de commun avec vous » (« At illum in aliis mundi finibus sua virtus collocavit, nihil vobiscum commune habentem ») 5. Il se retira du monde et des affaires du monde avec sa femme, Pauline, et il prétexta quelque maladie pour ne point sortir de chez lui.
- Autrefois traduit « Cent Vingt-quatre Épîtres, ou Divers Discours philosophiques à Lucilius » ou « Épîtres ».
- En latin Lucius Annæus Seneca.
- le comte Joseph de Maistre, « Œuvres complètes. Tome V. Les Soirées de Saint-Pétersbourg (suite et fin) ».