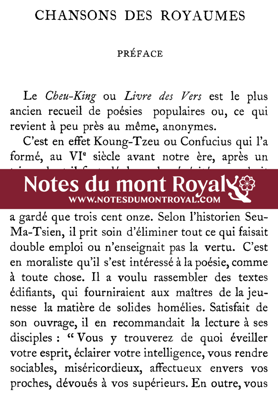
dans « La Nouvelle Revue française », nº 7, p. 5-14 ; nº 8, p. 130-136 ; nº 9, p. 195-204
Il s’agit d’une traduction partielle du « Shi Jing » 1, ou « Le Livre des vers ». Le caractère « shi » signifie « vers, pièce de vers, poème », parce qu’en effet tout ce livre ne contient que des odes, composées entre le XIe et le VIe siècle av. J.-C. On y voit décrites les plus anciennes coutumes des Chinois, leurs relations aux ancêtres, au ciel, aux autres pouvoirs, leurs rites millénaires participant au rythme sacré des saisons. Confucius faisait grand cas de ces odes et assurait que la doctrine en était très pure et très sainte : « As-tu travaillé la première et la seconde partie du “Shi Jing” ? », dit-il 2. « Qui voudrait faire son métier d’homme sans travailler la première et la seconde partie du “Shi Jing” restera comme planté le nez contre un mur. » Et encore : « Mes enfants, pourquoi aucun de vous n’étudie-t-il le “Shi Jing” ? Le “Shi Jing” permet de stimuler, permet d’observer, permet de communier, permet de protester. En famille, il vous aidera à servir votre père ; dans le monde, il vous aidera à servir votre souverain. Et vous y apprendrez les noms de beaucoup d’oiseaux, bêtes, plantes et arbres » 3. En même temps, le sublime philosophe prenait le parti de découvrir dans ces odes une intention morale, un but politique que personne n’eût soupçonnés : « Une seule phrase peut résumer les trois cents odes du “Shi Jing”, et c’est “penser droit” » 4. Les commentateurs chinois ont suivi cette générosité d’interprétation du grand sage ; ils l’ont même largement dépassée. Ils ont rivalisé d’ingéniosité et environné le « Shi Jing » d’un amas d’exégèse qui a fini par en obscurcir le sens primitif.
- En chinois « 詩經 ». Parfois transcrit « Cheu King », « Che’-king », « She King », « Shih Ching », « Schi-king », « Shi King », « Xi Kim », « Chi-kin » ou « Chi King ».
- « Les Entretiens de Confucius ; traduit du chinois par Pierre Ryckmans », XVII, 10.



















