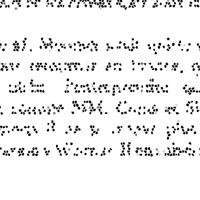Il s’agit de la relation « Le Grand Voyage du pays des Hurons » du frère Gabriel Sagard, missionnaire français, qui a fidèlement décrit le quotidien des Indiens parmi lesquels il vécut pendant près d’un an, ainsi que l’œuvre divine qu’il eut la conviction d’accomplir, lorsque, la croix sur le cœur, le regard au ciel, il vint s’enfoncer dans les solitudes du Canada. Il en a tiré deux relations : « Le Grand Voyage du pays des Hurons » et « Histoire du Canada », qui sont précieuses en ce qu’elles nous renseignent sur les mœurs et l’esprit de tribus aujourd’hui éteintes ou réduites à une poignée d’hommes. Ce fut le 18 mars 1623 que le frère Sagard partit de Paris, à pied et sans argent, voyageant « à l’apostolique » 1, pour se rendre à Dieppe, lieu de l’embarquement. La grande et épouvantable traversée de l’océan l’incommoda fort et le contraignit « de rendre le tribut à la mer [de vomir] » tout au long des trois mois et six jours de navigation qu’il lui fallut pour arriver à la ville de Québec. De là, « ayant traversé d’île en île » en petit canot, il prit terre au pays des Hurons tant désiré « par un jour de dimanche, fête de Saint-Bernard 2, environ midi, [alors] que le soleil donnait à plomb » 3. Tous les Indiens sortirent de leurs cabanes pour venir le voir et lui firent un fort bon accueil à leur façon ; et par des caresses extraordinaires, ils lui témoignèrent « l’aise et le contentement » qu’ils avaient de sa venue. Notre zélé religieux se mit aussitôt à l’étude de la langue huronne, dont il ne manqua pas de dresser un lexique : « J’écrivais, et observant soigneusement les mots de la langue… j’en dressais des mémoires que j’étudiais et répétais devant mes sauvages, lesquels y prenaient plaisir et m’aidaient à m’y perfectionner… ; m’[appelant] souvent “Aviel”, au lieu de “Gabriel” qu’ils ne pouvaient prononcer à cause de la lettre “b” qui ne se trouve point en toute leur langue… “Gabriel, prends ta plume et écris”, puis ils m’expliquaient au mieux qu’ils pouvaient ce que je désirais savoir » 4. Peu à peu, il parvint à s’habituer dans un lieu si misérable. Peu à peu, aussi, il apprit la langue des Indiens. Il s’entretint alors fraternellement avec eux ; il les attendrit par sa mansuétude et douceur ; et comme il se montrait toujours si bon envers eux, il les persuada aisément que le Dieu dont il leur prêchait la loi, était le bon Dieu. « Telle a été l’action bienfaisante de la France dans ses possessions d’Amérique. Au Sud, les Espagnols suppliciaient, massacraient la pauvre race indienne. Au Nord, les Anglais la refoulaient de zone en zone jusque dans les froids et arides déserts. Nos missionnaires l’adoucissaient et l’humanisaient », dit Xavier Marmier
Nhok Thèm, « La Rose de Païlin »
Il s’agit du « Kùlàp Pailin » 1 (« La Rose de Païlin ») de M. Nhok Thèm 2, romancier cambodgien, traducteur de « jâtakas » (« récits de faits auxquels le Bouddha a été mêlé »), fondateur de l’Association des écrivains khmers. « Grand lettré traditionnel et grand romancier de son temps, ses travaux culturels et religieux et ses romans eurent une profonde influence sur la culture littéraire dans le Cambodge contemporain », dit un critique 3. Né en 1903 au village de Svay Po, M. Nhok Thèm fit ses études religieuses et morales dans les écoles de pagode au Cambodge et en Thaïlande. À l’âge de quinze ans, il entra dans l’ordre bouddhique en tant que novice et il ne le quitta, vingt ans plus tard, que pour mieux participer aux publications de l’Institut bouddhique, qui venait d’ouvrir ses portes à Phnom Penh. Outre ces publications spéciales, M. Nhok Thèm laissa deux romans dont l’un, le « Pisàc snehà » 4 (« L’Amour diabolique ») fut publié en 1942, et dont l’autre, le « Kùlàp Pailin », fut inscrit au programme de l’enseignement secondaire en 1958. Rompant avec le cadre traditionnel des récits en vers, ces romans se différenciaient par leur modernité : ils étaient écrits exclusivement en prose, dans un langage ordinaire et courant, accessible à tout le monde, et ils mettaient en scène — non plus de jeunes princes ou des êtres surnaturels, comme la littérature classique — mais des personnages bien contemporains, faisant partie des diverses couches de la société : paysans, mineurs, petits fonctionnaires, avec leurs aspirations, leurs préoccupations et leurs difficultés quotidiennes. « Ils se caractérisent par un canevas assez simple, dont le noyau principal est souvent axé sur les destinées de deux jeunes gens qui ont à faire face à des obstacles de différents ordres avant de voir se réaliser — ou sombrer — leur amour et leur mariage », dit un autre critique 5.
Quinte-Curce, « Œuvres complètes »
Il s’agit de l’« Histoire d’Alexandre le Grand » (« Historia Alexandri Magni ») 1, l’unique œuvre de Quinte-Curce 2 (Ier siècle apr. J.-C.). On dit que la lecture de « L’Iliade » charmait si fort Alexandre le Grand, qu’à peine arrivé en Asie Mineure, il s’arrêta sur la tombe d’Achille et s’écria : « Heureux jeune homme qui as trouvé un Homère pour chanter ta valeur ! » 3 Le célèbre conquérant peut toutefois se consoler de n’avoir pas eu, comme Achille, un Homère pour chantre de ses exploits, puisqu’il a trouvé, parmi les Latins, un historien de sa vie tel que Quinte-Curce. Ce biographe a l’avantage d’être un auteur de premier rang qui, indépendamment des multiples détails qu’il a puisés à des sources plus anciennes, nous montre une beauté de coloris, une inspiration d’ensemble, un relief que n’ont pas les autres historiens de la latinité : « Une page de Quinte-Curce vaut mieux que trente de Tacite », dit un critique 4. « J’en puis juger, car je l’ai autant manié qu’[un] homme de France ; j’en ai là-dedans un [exemplaire] où il n’y a ligne que je n’aie marquée… Quinte-Curce est le premier de la latinité : si poli, si… clair et intelligible. » J’ajouterai que Quinte-Curce est inégalable dans toutes les harangues et allocutions qu’il a prêtées aux héros de son ouvrage. À peine peut-on s’imaginer qu’elles sont de sa propre invention, et nous les trouvons si ajustées aux personnes qui les prononcent, qu’elles passent dans notre esprit pour une copie exécutée sur le véritable original de Callisthènes, d’Onésicrite, de Néarque ou de quelque autre parmi les chroniqueurs compagnons d’Alexandre. Celle-ci, par exemple :
« Alexandre fait asseoir ses amis tout près de lui, pour éviter de rouvrir, par quelque effort de voix, sa blessure à peine cicatrisée. Dans sa tente étaient Héphestion, Cratère et Érigyius, avec ses gardes… “Si nous passons le Tanaïs”, leur dit-il, “si… nous montrons que partout nous sommes invincibles, qui doutera alors que l’Europe même soit ouverte à nos conquêtes ? Ce serait se tromper que de mesurer la gloire qui nous attend, à l’espace que nous avons à franchir. Ce n’est qu’un fleuve ; mais si nous le passons, nous portons nos armes en Europe. Et de quel prix n’est-il pas pour nous, pendant que nous conquérons l’Asie… de réunir entre elles tout d’un coup, par une seule victoire, des contrées que la nature semble avoir séparées par de si lointains espaces ?” »
- Également connu sous le titre de « De la vie et des actions d’Alexandre le Grand » (« De rebus gestis Alexandri Magni »).
- En latin Quintus Curtius Rufus. Parfois transcrit Quinte Curse.
« Dictionnaire des proverbes danois »
Il s’agit d’un recueil de proverbes danois. Nul genre d’enseignement n’est plus ancien que celui des proverbes. Son origine remonte aux âges les plus reculés du globe. Dès que les hommes, mus par un instinct irrésistible ou poussés par la volonté divine, se furent réunis en société ; dès qu’ils eurent constitué un langage suffisant à l’expression de leurs besoins, les proverbes prirent naissance en tant que résumé naturel des idées communes de l’humanité. « S’ils avaient pu se conserver, s’ils étaient parvenus jusqu’à nous sous leur forme primitive », dit Pierre-Marie Quitard 1, « ils seraient le plus curieux monument du progrès des premières sociétés ; ils jetteraient un jour merveilleux sur l’histoire de la civilisation, dont ils marqueraient le point de départ avec une irrécusable fidélité. » La Bible, qui contient plusieurs livres de proverbes, dit : « Celui qui applique son âme à réfléchir sur la Loi du Très-Haut… recherche le sens secret des proverbes et revient sans cesse sur les énigmes des maximes » 2. Les sages de la Grèce eurent la même pensée que la Bible. Confucius imita les proverbes et fut à son tour imité par ses disciples. De même que l’âge de l’arbre peut se juger par le tronc ; de même, les proverbes nous apprennent le génie ou l’esprit propre à chaque nation, et les détails de sa vie privée. On en tenait certains en telle estime, qu’on les disait d’origine céleste : « C’est du ciel », dit Juvénal 3, « que nous est venue la maxime : “Connais-toi toi-même”. Il la faudrait graver dans son cœur et la méditer toujours. » C’est pourquoi, d’ailleurs, on les gravait sur le devant des portes des temples, sur les colonnes et les marbres. Ces inscriptions, très nombreuses du temps de Platon, faisaient dire à ce philosophe qu’on pouvait faire un excellent cours de morale en voyageant à pied, si l’on voulait les lire ; les proverbes étant « le fruit de l’expérience de tous les peuples et comme le bon sens de tous les siècles réduit en formules »
- « Études historiques, littéraires et morales sur les proverbes français et le langage proverbial », p. 2.
- « Livre de l’Ecclésiastique », XXXIX, 1-3.
« Mémoire sur Khâcâni [ou Khagani] : poète persan du XIIᵉ siècle »
Il s’agit de Khagani Chirvani 1 (XIIe siècle apr. J.-C.), excellent poète persan, chantre attitré du sultan de la principauté de Chirvan 2 (Azerbaïdjan). Khagani s’est décrit lui-même, avec la modestie qui le caractérisait, en ces mots : « Je suis grand, je suis du nombre des esprits ; je suis du monde occulte et je suis saint par ma naissance. Comment est-il donc possible que mon être puisse se laisser subjuguer par la matière ? La raison me servit de gouvernante ; ma nourriture était la loi du Prophète ; l’esprit était mon berceau » 3. Et ailleurs : « L’an 500 [1106 apr. J.-C.] ne produisit pas un homme digne de m’être comparé ; ce n’est pas un mensonge, moi j’en suis la preuve » 4. Il naquit à Chamakha 5 d’un père musulman et d’une mère chrétienne, mais fut bientôt abandonné aux soins de son oncle, Mirza Kafi, médecin et droguiste. Ce dernier eut une grande influence sur la jeunesse de notre poète. C’est lui qui, chaque soir, après avoir fermé sa boutique, lui enseignait la langue arabe, la médecine, l’astronomie et la métaphysique. Malgré tout son attachement pour son neveu, le pédagogue oriental, fidèle au système d’éducation généralement admis, avait souvent recours au bâton pour stimuler le zèle de son élève. Notre poète parle de ces corrections corporelles d’une manière originale ; il dit notamment : « En ai-je mangé du gourdin dans sa boutique ! Il m’amollissait par le bâton comme on amollit une grenade. On compte parmi les miracles de Moïse qu’en jetant sa baguette, il la convertissait en serpent ; mais mon oncle découvrait le vrai dans mon cœur au moyen de sa baguette, et il traçait sur mon corps les figures des serpents de Moïse » 6. Khagani épousa une villageoise, à cause de laquelle il devint la cible des moqueries des courtisans. Et pourtant, il refusa d’épouser une autre femme et resta auprès de la sienne, qui était faible et d’une constitution maladive. Voici ce qu’il dit dans une lettre : « Pendant les temps des maladies, c’était moi qui prenais soin de cette défunte, son serviteur, et qui lui présentais la cuvette et lui donnais de l’eau pour se laver les mains ; et quand elle a quitté ce monde, comme il était entendu entre nous, je suis parti de Chirvan. Je jure sur la personne de Dieu, qu’il n’y a aucune autre cause qui puisse me tenir éloigné de mon pays, bien que l’ami et l’ennemi pensent autrement ; mais ce que j’ai dit c’est la vérité même » 7. La perte de sa femme inspira au poète trois pièces de vers, dont la première se remarque par l’expression vraie du sentiment qui l’a dictée. De toutes les poésies de Khagani, c’est la seule où il apparaît un homme sincère, la douleur lui faisant oublier, l’espace d’un moment, son rôle convenu de poète attaché à la Cour des princes de l’Asie
« Proverbes chinois »
Il s’agit d’un recueil de proverbes chinois. Nul genre d’enseignement n’est plus ancien que celui des proverbes. Son origine remonte aux âges les plus reculés du globe. Dès que les hommes, mus par un instinct irrésistible ou poussés par la volonté divine, se furent réunis en société ; dès qu’ils eurent constitué un langage suffisant à l’expression de leurs besoins, les proverbes prirent naissance en tant que résumé naturel des idées communes de l’humanité. « S’ils avaient pu se conserver, s’ils étaient parvenus jusqu’à nous sous leur forme primitive », dit Pierre-Marie Quitard 1, « ils seraient le plus curieux monument du progrès des premières sociétés ; ils jetteraient un jour merveilleux sur l’histoire de la civilisation, dont ils marqueraient le point de départ avec une irrécusable fidélité. » La Bible, qui contient plusieurs livres de proverbes, dit : « Celui qui applique son âme à réfléchir sur la Loi du Très-Haut… recherche le sens secret des proverbes et revient sans cesse sur les énigmes des maximes » 2. Les sages de la Grèce eurent la même pensée que la Bible. Confucius imita les proverbes et fut à son tour imité par ses disciples. De même que l’âge de l’arbre peut se juger par le tronc ; de même, les proverbes nous apprennent le génie ou l’esprit propre à chaque nation, et les détails de sa vie privée. On en tenait certains en telle estime, qu’on les disait d’origine céleste : « C’est du ciel », dit Juvénal 3, « que nous est venue la maxime : “Connais-toi toi-même”. Il la faudrait graver dans son cœur et la méditer toujours. » C’est pourquoi, d’ailleurs, on les gravait sur le devant des portes des temples, sur les colonnes et les marbres. Ces inscriptions, très nombreuses du temps de Platon, faisaient dire à ce philosophe qu’on pouvait faire un excellent cours de morale en voyageant à pied, si l’on voulait les lire ; les proverbes étant « le fruit de l’expérience de tous les peuples et comme le bon sens de tous les siècles réduit en formules »
- « Études historiques, littéraires et morales sur les proverbes français et le langage proverbial », p. 2.
- « Livre de l’Ecclésiastique », XXXIX, 1-3.
« Sentences, Maximes et Proverbes mandchous et mongols »
Il s’agit d’un recueil de proverbes mandchous et mongols. Nul genre d’enseignement n’est plus ancien que celui des proverbes. Son origine remonte aux âges les plus reculés du globe. Dès que les hommes, mus par un instinct irrésistible ou poussés par la volonté divine, se furent réunis en société ; dès qu’ils eurent constitué un langage suffisant à l’expression de leurs besoins, les proverbes prirent naissance en tant que résumé naturel des idées communes de l’humanité. « S’ils avaient pu se conserver, s’ils étaient parvenus jusqu’à nous sous leur forme primitive », dit Pierre-Marie Quitard 1, « ils seraient le plus curieux monument du progrès des premières sociétés ; ils jetteraient un jour merveilleux sur l’histoire de la civilisation, dont ils marqueraient le point de départ avec une irrécusable fidélité. » La Bible, qui contient plusieurs livres de proverbes, dit : « Celui qui applique son âme à réfléchir sur la Loi du Très-Haut… recherche le sens secret des proverbes et revient sans cesse sur les énigmes des maximes » 2. Les sages de la Grèce eurent la même pensée que la Bible. Confucius imita les proverbes et fut à son tour imité par ses disciples. De même que l’âge de l’arbre peut se juger par le tronc ; de même, les proverbes nous apprennent le génie ou l’esprit propre à chaque nation, et les détails de sa vie privée. On en tenait certains en telle estime, qu’on les disait d’origine céleste : « C’est du ciel », dit Juvénal 3, « que nous est venue la maxime : “Connais-toi toi-même”. Il la faudrait graver dans son cœur et la méditer toujours. » C’est pourquoi, d’ailleurs, on les gravait sur le devant des portes des temples, sur les colonnes et les marbres. Ces inscriptions, très nombreuses du temps de Platon, faisaient dire à ce philosophe qu’on pouvait faire un excellent cours de morale en voyageant à pied, si l’on voulait les lire ; les proverbes étant « le fruit de l’expérience de tous les peuples et comme le bon sens de tous les siècles réduit en formules »
- « Études historiques, littéraires et morales sur les proverbes français et le langage proverbial », p. 2.
- « Livre de l’Ecclésiastique », XXXIX, 1-3.
« La Comédie de proverbes : pièce comique »

éd. Droz, coll. Textes littéraires français, Genève
Il s’agit d’un recueil de proverbes français. Nul genre d’enseignement n’est plus ancien que celui des proverbes. Son origine remonte aux âges les plus reculés du globe. Dès que les hommes, mus par un instinct irrésistible ou poussés par la volonté divine, se furent réunis en société ; dès qu’ils eurent constitué un langage suffisant à l’expression de leurs besoins, les proverbes prirent naissance en tant que résumé naturel des idées communes de l’humanité. « S’ils avaient pu se conserver, s’ils étaient parvenus jusqu’à nous sous leur forme primitive », dit Pierre-Marie Quitard 1, « ils seraient le plus curieux monument du progrès des premières sociétés ; ils jetteraient un jour merveilleux sur l’histoire de la civilisation, dont ils marqueraient le point de départ avec une irrécusable fidélité. » La Bible, qui contient plusieurs livres de proverbes, dit : « Celui qui applique son âme à réfléchir sur la Loi du Très-Haut… recherche le sens secret des proverbes et revient sans cesse sur les énigmes des maximes » 2. Les sages de la Grèce eurent la même pensée que la Bible. Confucius imita les proverbes et fut à son tour imité par ses disciples. De même que l’âge de l’arbre peut se juger par le tronc ; de même, les proverbes nous apprennent le génie ou l’esprit propre à chaque nation, et les détails de sa vie privée. On en tenait certains en telle estime, qu’on les disait d’origine céleste : « C’est du ciel », dit Juvénal 3, « que nous est venue la maxime : “Connais-toi toi-même”. Il la faudrait graver dans son cœur et la méditer toujours. » C’est pourquoi, d’ailleurs, on les gravait sur le devant des portes des temples, sur les colonnes et les marbres. Ces inscriptions, très nombreuses du temps de Platon, faisaient dire à ce philosophe qu’on pouvait faire un excellent cours de morale en voyageant à pied, si l’on voulait les lire ; les proverbes étant « le fruit de l’expérience de tous les peuples et comme le bon sens de tous les siècles réduit en formules »
« Proverbes [laotiens] »
Il s’agit d’un recueil de proverbes laotiens. Nul genre d’enseignement n’est plus ancien que celui des proverbes. Son origine remonte aux âges les plus reculés du globe. Dès que les hommes, mus par un instinct irrésistible ou poussés par la volonté divine, se furent réunis en société ; dès qu’ils eurent constitué un langage suffisant à l’expression de leurs besoins, les proverbes prirent naissance en tant que résumé naturel des idées communes de l’humanité. « S’ils avaient pu se conserver, s’ils étaient parvenus jusqu’à nous sous leur forme primitive », dit Pierre-Marie Quitard 1, « ils seraient le plus curieux monument du progrès des premières sociétés ; ils jetteraient un jour merveilleux sur l’histoire de la civilisation, dont ils marqueraient le point de départ avec une irrécusable fidélité. » La Bible, qui contient plusieurs livres de proverbes, dit : « Celui qui applique son âme à réfléchir sur la Loi du Très-Haut… recherche le sens secret des proverbes et revient sans cesse sur les énigmes des maximes » 2. Les sages de la Grèce eurent la même pensée que la Bible. Confucius imita les proverbes et fut à son tour imité par ses disciples. De même que l’âge de l’arbre peut se juger par le tronc ; de même, les proverbes nous apprennent le génie ou l’esprit propre à chaque nation, et les détails de sa vie privée. On en tenait certains en telle estime, qu’on les disait d’origine céleste : « C’est du ciel », dit Juvénal 3, « que nous est venue la maxime : “Connais-toi toi-même”. Il la faudrait graver dans son cœur et la méditer toujours. » C’est pourquoi, d’ailleurs, on les gravait sur le devant des portes des temples, sur les colonnes et les marbres. Ces inscriptions, très nombreuses du temps de Platon, faisaient dire à ce philosophe qu’on pouvait faire un excellent cours de morale en voyageant à pied, si l’on voulait les lire ; les proverbes étant « le fruit de l’expérience de tous les peuples et comme le bon sens de tous les siècles réduit en formules »
- « Études historiques, littéraires et morales sur les proverbes français et le langage proverbial », p. 2.
- « Livre de l’Ecclésiastique », XXXIX, 1-3.
Nâsir, « “Sefer Namèh”, Relation d’un voyage en Syrie, en Palestine, en Égypte, en Arabie et en Perse »
Il s’agit du « Safar-nâmeh » 1, relation du voyage de Nâsir-e Khosraw 2 en Syrie, en Palestine, en Égypte, en Arabie et en Perse. Nâsir naquit en l’an 1004 apr. J.-C. ainsi qu’il nous l’apprend lui-même : « Il s’était écoulé trois cent quatre-vingt-quatorze ans depuis l’hégire, quand ma mère me déposa dans cette demeure poudreuse. Je poussai, ignorant de tout, et semblable à une plante qui naît de la terre noire… C’est à la quatrième période que je sentis que j’appartenais à l’humanité, lorsque mon être, voué à la tristesse, put articuler des paroles » 3. Ses ancêtres avaient quitté Bagdad pour venir s’établir dans la ville de Balkh 4. Lui-même désigne cette ville comme la résidence de sa famille : « Ô brise de l’après-midi », dit-il 5, « si tu passes sur le pays de Balkh, passe sur ma maison et enquiers-toi de l’état des miens ». Il s’adonna dans sa jeunesse aux plaisirs et à la dissipation. En 1045 apr. J.-C., un saint personnage lui apparut en songe et lui reprocha ses erreurs et ses transgressions continuelles des lois divines. Nâsir demanda quelle voie il devait suivre, et sur un signe qu’il crut lui indiquer la direction de la Mecque, il se démit de son emploi, rendit ses comptes et se mit en route, avec son frère et un petit esclave indien, pour un voyage qui devait durer sept ans : « Souvent, dans le cours de mon voyage, je n’ai eu que la pierre pour matelas et pour oreiller
- En persan « سفرنامه ». Parfois transcrit « Sefer Namèh », « Sefer-nāme », « Safarnoma », « Safar-nāma » ou « Safar-nāmah ».
- En persan ناصرخسرو. Parfois transcrit Nāṣer Ḫosrov, Nāṣer-e Ḫosrou, Nāsir-i-Khosro, Nassiri Khosrau, Nâṣir-i-Ḫusrau, Nāṣir è Ḫosraw, Naser-e Khosrow, Nâçir Khosroû, Nasir Khusrow, Naser Josrow, Nasser Chosrau, Naseer Khusrau ou Nasir Khusraw.
- p. XVIII.
- Aujourd’hui rattachée à l’Afghanistan.
- p. XVIII.
« Abou ṭ-Ṭayyib al-Motanabbî, un poète arabe du Xᵉ siècle : essai d’histoire littéraire »
Il s’agit d’Abou’ltayyib 1, surnommé Moténabbi 2, orgueilleux poète de Cour, rendu célèbre en servant différents princes arabes, en chantant leurs hauts faits et leurs bienfaits, en se brouillant avec eux, en se vengeant par des satires des louanges qu’il leur avait données auparavant. Ses poèmes ont quelquefois de la beauté dans leur éloquence ; mais, plus souvent encore, ils ne brillent que par ce singulier mélange d’insolence et de politesse, de bassesse et d’orgueil qui distingue les courtisans ; cet art de plaire aux grands en se moquant d’eux. Si l’on en croit ses rivaux, ce poète était le fils d’un simple porteur d’eau dans la ville de Koufa (en Irak), quoiqu’il se vantât beaucoup de sa noblesse. Dès sa jeunesse, il fut tourmenté par une ambition incommensurable, réconfortée par les succès de sa poésie, qui était payée très chèrement par les princes auxquels il s’attachait. Bientôt, la tête lui tourna, et il crut pouvoir passer à un aussi juste titre pour prophète en vers, que Mahomet l’avait été en prose ; cela lui valut le surnom de Moténabbi (« celui qui se prétend prophète »). Mais, enfin, quand il se vit dans l’impossibilité de réaliser cet idéal ; quand le temps et les occasions le détrompèrent en le rappelant à une vie si brève, si ordinaire, si fatalement humaine ; quand il songea que des pans entiers de son ambitieuse nature resteraient à jamais ensevelis dans l’ombre, ce fut un débordement d’une amertume sans pareille. « De là, cet amour-propre qui, au lieu de rechercher à bien faire pour gagner l’estime d’autrui et devenir altruisme, se transforme en égoïsme haineux et malveillant à l’égard des autres [ou en] joie quand ils ont échoué », dit M. Joseph Daher 3. Témoin les vers suivants où il dit aux hommes tout le mépris et toute la haine qu’ils lui inspirent : « Je critique les petites gens de ce siècle, car le plus docte d’entre eux est un crétin, le plus énergique un lâche, le plus noble un chien, le plus clairvoyant un aveugle, le plus vigilant un loir, et le plus courageux un singe ».
- En arabe أبو الطيب. Parfois transcrit Abou’l Tayib, Abou ṭ-Ṭayyib, Aboul Thaïeb ou Abū al-Ṭaiyib.
- En arabe المتنبي. Parfois transcrit Motanabbî, Motanabby, Moténabby, Motenabi, Motenebbi, Moutanabbi, Moutanabi, Mutanabi ou Mutanabbī.
- « Essai sur le pessimisme chez le poète arabe al-Mutanabbī », p. 54.
« La Reine exilée et son Fils : poème épique laotien narrant une des vies du Bouddha »
Il s’agit du « nāṅ Tēṅ an1 » 1 (« La Reine exilée et son Fils », ou littéralement « La Dame Tēṅ an1 »), un des romans épiques du Laos. Les Laotiens ont une prédilection marquée pour les longs récits en vers, imprégnés de bouddhisme, et relevés par la fantaisie et par l’agencement des aventures. Ils les appellent « bœ̄n2 vănnaḥgaḥtī » 2 (« textes littéraires »). Ils les lisent dans les réunions ; ils les récitent pendant la nuit aux jeunes femmes récemment accouchées, pour les empêcher de succomber au sommeil et de devenir ainsi une proie facile pour les mauvais esprits. Certains de ces romans épiques sont d’une longueur accablante : le « dāv2 kālaḥket » 3, par exemple, compte à peu près dix mille vers, et le « cāṃPā sī1 Tŏn2 » 4 — environ quatorze mille. « Il faut croire que les péripéties qui forment la trame du récit en font tolérer la longueur », dit Louis Finot 5. « Pourtant ni les acteurs ni les incidents du drame ne brillent par la variété : les mêmes figures et les mêmes scènes se représentent sans cesse avec une monotonie qui lasserait le lecteur le plus intrépide, mais qui ne paraît pas déplaire aux âmes simples pour lesquelles des bardes anonymes ont composé ces enfantines rhapsodies. » Je l’avoue : ces romans épiques, en général fort maladroits, tracés pour la plupart par des mains laborieuses, m’ont touché. Je les ai ouverts souvent avec dédain, et presque jamais je ne les ai fermés sans être ému. La forme, à très peu d’exceptions près, en est défectueuse, mais cela par rudesse plutôt que par mauvais goût. Ils respirent tant de sincérité, de sympathie, de bonne volonté ; on y trouve des sentiments si respectables dans leur naïveté, que moi, qui étais décidé à en rire, j’ai toujours fini par m’y plaire. Jamais je n’accueillerai par la raillerie cette confession honnête d’un poète :
« Moi, qui ai composé ce récit versifié,
Je me suis enfui au loin, tout comme la petite [héroïne dont je vous parle] !
Car moi, votre serviteur, couche en solitaire ;
Je suis bien seul, dans ma chambre, les bras pendant dans le vide…
Depuis que j’ai quitté ma maison pour aller chez les Thaï où je n’ai pas d’amis,
Je m’efforce d’écrire des vers pour me réchauffer le cœur.
Tout au fond de mon être… je me dis que je finirai par rentrer chez moi.
Ils sont évidemment bien éloignés l’un de l’autre, la cité d’or et le pays natal ! »
- En laotien « ນາງແຕງອ່ອນ ». Parfois transcrit « Nang Tèng One », « Naṅ Teṅ On », « Nāng Tǣng ‘Ǭn », « Nang Taeng Oon » ou « Nang Taeng Aun ».
- En laotien ພື້ນວັນນະຄະດີ.
- En laotien « ທ້າວກາລະເກດ », inédit en français.
- En laotien « ຈໍາປາສີ່ຕົ້ນ », inédit en français.
- « Recherches sur la littérature laotienne », p. 116.
« L’Engoulevent blanc »

dans « Le Roman classique lao » (éd. École française d’Extrême-Orient, coll. Publications de l’École française d’Extrême-Orient, Paris)
Il s’agit du « dāv2 nŏk kaḥpā phœ̄eak » 1 (« L’Engoulevent blanc »), un des romans épiques du Laos. Les Laotiens ont une prédilection marquée pour les longs récits en vers, imprégnés de bouddhisme, et relevés par la fantaisie et par l’agencement des aventures. Ils les appellent « bœ̄n2 vănnaḥgaḥtī » 2 (« textes littéraires »). Ils les lisent dans les réunions ; ils les récitent pendant la nuit aux jeunes femmes récemment accouchées, pour les empêcher de succomber au sommeil et de devenir ainsi une proie facile pour les mauvais esprits. Certains de ces romans épiques sont d’une longueur accablante : le « dāv2 kālaḥket » 3, par exemple, compte à peu près dix mille vers, et le « cāṃPā sī1 Tŏn2 » 4 — environ quatorze mille. « Il faut croire que les péripéties qui forment la trame du récit en font tolérer la longueur », dit Louis Finot 5. « Pourtant ni les acteurs ni les incidents du drame ne brillent par la variété : les mêmes figures et les mêmes scènes se représentent sans cesse avec une monotonie qui lasserait le lecteur le plus intrépide, mais qui ne paraît pas déplaire aux âmes simples pour lesquelles des bardes anonymes ont composé ces enfantines rhapsodies. » Je l’avoue : ces romans épiques, en général fort maladroits, tracés pour la plupart par des mains laborieuses, m’ont touché. Je les ai ouverts souvent avec dédain, et presque jamais je ne les ai fermés sans être ému. La forme, à très peu d’exceptions près, en est défectueuse, mais cela par rudesse plutôt que par mauvais goût. Ils respirent tant de sincérité, de sympathie, de bonne volonté ; on y trouve des sentiments si respectables dans leur naïveté, que moi, qui étais décidé à en rire, j’ai toujours fini par m’y plaire. Jamais je n’accueillerai par la raillerie cette confession honnête d’un poète :
« Moi, qui ai composé ce récit versifié,
Je me suis enfui au loin, tout comme la petite [héroïne dont je vous parle] !
Car moi, votre serviteur, couche en solitaire ;
Je suis bien seul, dans ma chambre, les bras pendant dans le vide…
Depuis que j’ai quitté ma maison pour aller chez les Thaï où je n’ai pas d’amis,
Je m’efforce d’écrire des vers pour me réchauffer le cœur.
Tout au fond de mon être… je me dis que je finirai par rentrer chez moi.
Ils sont évidemment bien éloignés l’un de l’autre, la cité d’or et le pays natal ! »
- En laotien « ທ້າວນົກກະບາເຜືອກ ». Parfois transcrit « Thao Nok Kaba Phueak » ou « Thao Nok Kaba Phüak ».
- En laotien ພື້ນວັນນະຄະດີ.
- En laotien « ທ້າວກາລະເກດ », inédit en français.
- En laotien « ຈໍາປາສີ່ຕົ້ນ », inédit en français.
- « Recherches sur la littérature laotienne », p. 116.